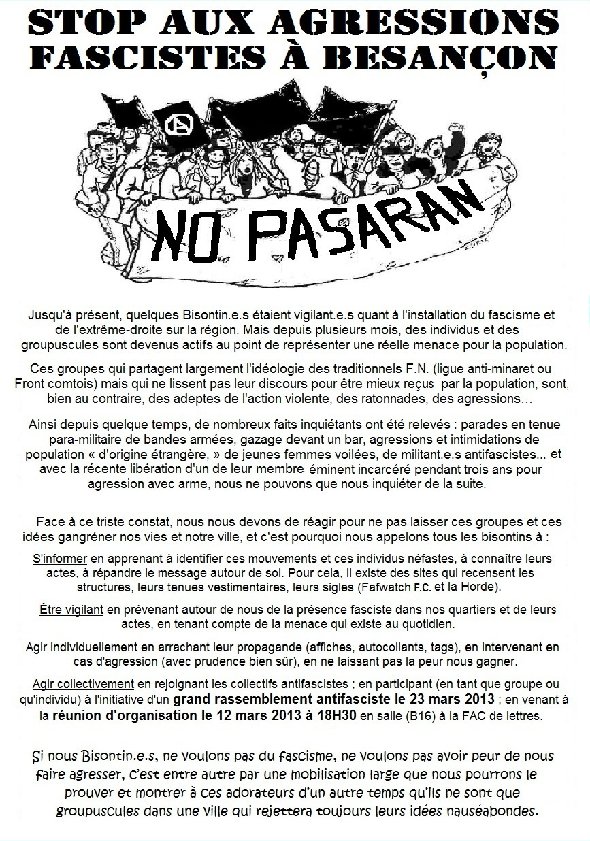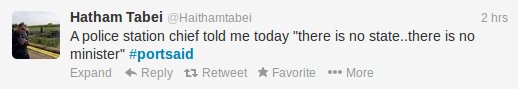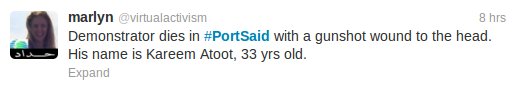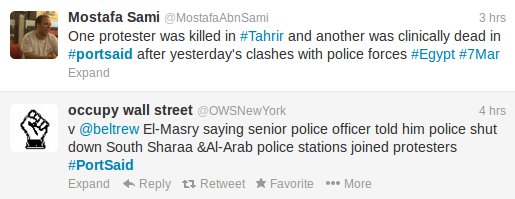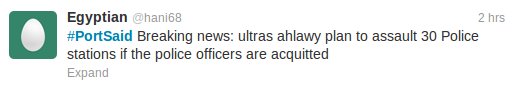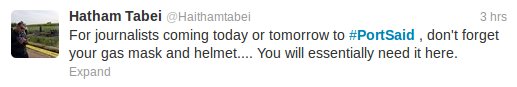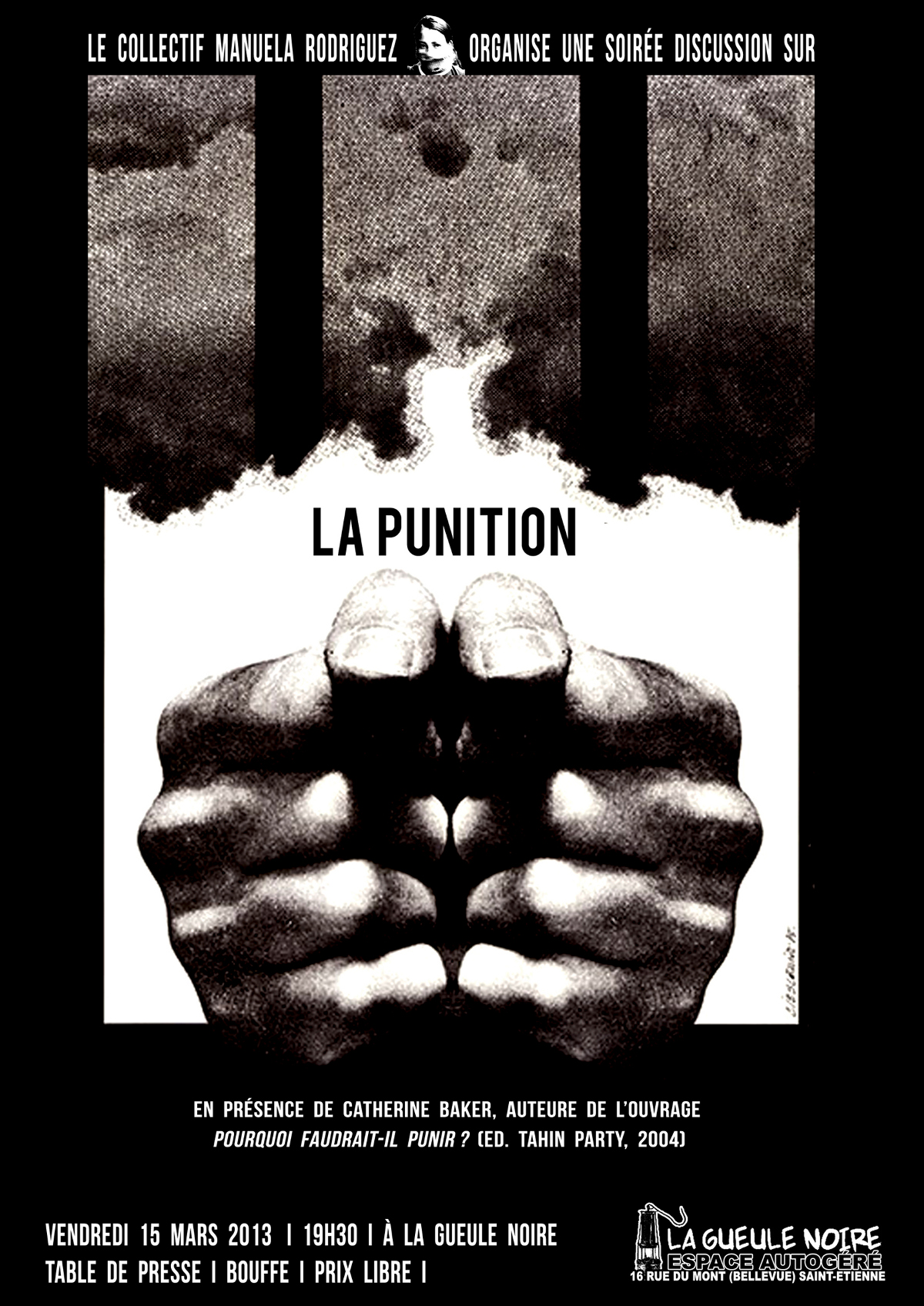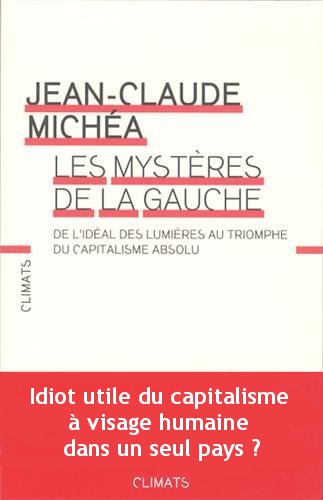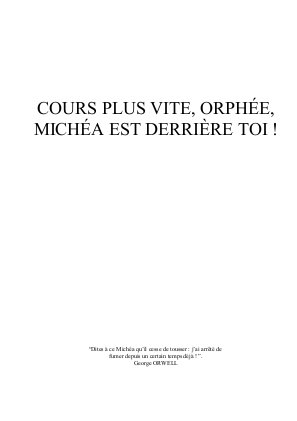De l’ontologie de Jean-Claude Michéa (National-nostalgique ?)
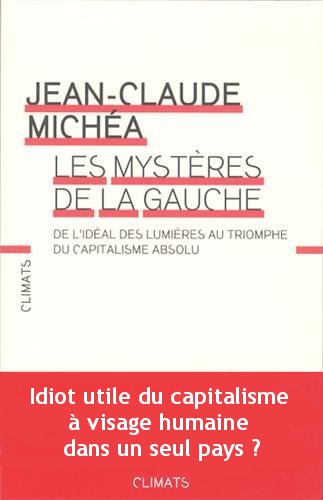
Nous n’allons pas faire ici l’exégèse de la pensée de Jean-Claude Michéa qui se rapproche encore plus certainement de la Nouvelle Droite avec son dernier ouvrage.
Michéa qui n’est pas avare de citations et de références a « oublié » de mentionner [Ce n’est bien sur pas cette « absence » de référence de note qui fait de Michéa un individu dont la pensée se rapproche un peu plus de la Nouvelle Droite, mais le contenu global. Contenu repris d’ailleurs par de nombreux sites d’extrême droite on ne se demande pas ici pourquoi !? La pensée de Michéa s’inscrit dans le prolongement du discours Clouscardien (voir notre article la révolution n’a pas eu lieu) ou toute tentative de résistance / combat contre le capitalisme est assimilé à sa « promotion ».] que la revue Krisis, qu’il cite en début de son volume, est celle d’Alain de Benoist (voir d’ailleurs à ce sujet notre article sur C. Preve et Denis Collin).
Est-ce la une référence aussi commune, anodine que cela ? Peut-être est-ce l’effet éducation « nationale » ! Ou le côté conservateur de son « anarchisme » ?
Nous présentons ici un extrait de son dernier texte qui ne mérite pas vraiment de commentaires tant sa position sur son « anti-capitalisme » est limpide !!
« Pour autant, cela ne signifie pas qu’une société socialiste décente pourrait se passer de marchés locaux, régionaux ou même internationaux (notamment dans le cadre d’une coopération mondiale des peuples). Le rêve d’une abolition intégrale de la logique marchande (au delà de la sphère des relations de face à face) impliquerait, en effet, que tous les besoins et les désirs des individus pourraient être définis et imposés par la collectivité, ce qui reviendrait inéluctablement à détruire l’un des fondements majeurs de la vie privée. Comme Marcel Mauss l’avait clairement annoncé, une société socialiste décente devra donc maintenir – à côté des secteurs domestiques, coopératifs ou publics – un secteur privé (dont l’ampleur ne saurait être limité a priori) et, par conséquent, un nombre, probablement important, d’entreprises privées. »
Page 117 Le complexe d’Orphée. Jean-Claude Michéa Éd. Climats 2011
Si le temps ne nous manque pas nous laisserons à la suite de ce texte les passages propres à la compréhension de l’ontologie de Jean-Claude Michéa (« peuple(s) » : où sont les prolétaires, les classes ? « enracinement », « authenticité », « défense de l’identité », critique du « sans frontièrisme » (sic), keynésianisme déguisé en anti-capitalisme bien plus proche de la « troisième voie » ou tercérisme que d’une rupture avec la marchandise et l’argent. Ceci au nom d’une morale populaire ontologisée !) plus proche de celle de Martin Heidegger que de la conception de la révolution sociale de Marx ou Bakounine.
Ajout du 6 mars 2013 (et dernier)
Pour écouter Michéa défendre le « Chavisme » et son « patriotisme » comme valeur du socialisme « décent » il faut simplement écouter les matins de France culture du 6 mars 2013.
Il faudra aussi que l’on se demande pourquoi celui-ci se laisse étiqueter aussi facilement comme « anarchiste/anarcho-syndicaliste » sans que cela ne questionne la sphère dite libertaire [Et le Jura Libertaire lui-même n’est pas exempt de critique – NdJL].
Si Michéa vient de découvrir qu’il existe une gauche du capital c’est pour mieux faire l’apologie de sa droite. Le problème c’est que Michéa n’est pas anti-capitaliste, sinon anti-libéral (voir ci-dessus) est-ce pour mieux défendre la tartuferie poujadiste d’un capitalisme régulé dans un seul pays, et la restauration de l’adoration du saint-drapeau ? Encore un néo-stal ou un national-nostalgique ?
Vosstanie, 6 mards 2013
MODE D’EMPLOI POUR SABORDER LA FLOTTILLE MICHÉENNE
Jean-Claude Michéa est un étrange philosophe. Le lire donne quelquefois le tournis. Qu’on en juge. Michéa préconise la plus grande méfiance à l’égard des médias officiels et accorde sans barguigner des entretiens au Point et au Nouvel Observateur, il signe un ouvrage commun avec Alain Finkielkraut et Pascal Bruckner tout en passant pour un penseur “radical”, il est fasciné par “l’intelligence exceptionnelle” du très élitiste Jean-Claude Milner mais défend bec et ongles le populisme, cet infatigable contempteur de mai 68 n’hésite pas à citer Guy Debord, etc., etc., etc.
Quel est donc ce Protée de la pensée, ce Fregoli de la philosophie ? Est-ce un dialecticien hors pair, capable de réconcilier tous ces contraires ? Ou la dernière des baudruches à la mode ? Ou alors, tout simplement, n’est-il rien de tout cela : mais un gars bien ordinaire, comme dirait Charlebois, amoureux du football et des plaisirs de la plage, que les hasards de l’existence et de l’édition auraient propulsé sur le devant de la scène ?
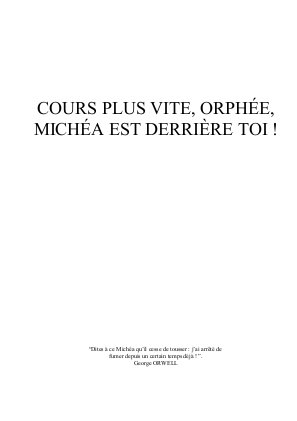
TÉLÉCHARGER LE TEXTE (novembre 2011)
Le lecteur des Essais, articles et lettres de George Orwell qui entamerait la lecture des publications de Jean-Claude Michéa par celle de son premier ouvrage, Orwell anarchiste tory, et la poursuivrait par (citons dans l’ordre) L’enseignement de l’ignorance, Impasse Adam Smith, George Orwell éducateur, L’empire du moindre mal et La double pensée aurait de bonnes raisons de s’interroger. Avait-il bien lu les six épais volumes d’essais de l’écrivain anglais ? Ne serait-il pas quelquefois passé à côté de son sujet ? Retournons la question. En se référant de livre en livre, continuellement, voire obsessionnellement à la notion proposée par Orwell de common decency, Michéa ne sollicite-t-il pas le texte orwellien au point d’en forcer le sens ?
À cette objection, Bruce Begout, l’auteur d’un ouvrage paru en 2008 aux éditions Allia, De la décence ordinaire, a déjà répondu. Dans ce petit essai Begout, qui traduit “common decency” par “décence ordinaire (et non “honnêteté” ou “moralité”) précise qu’il faut également entendre là “un comportement social et une certaine forme d’estime de soi”. Il ajoute (nous en venons à notre objection) qu’il trouve “regrettable que la traduction française des Essais, articles et lettres (par ailleurs remarquable) n’ait pas rendu la “common decency” par une formule unique, effaçant ainsi l’unité d’un concept central”. Certes, mais les traducteurs pourraient lui répondre qu’il n’y avait justement pas là matière à conceptualiser : qu’ils ont traduit Orwell au plus près, au plus juste, en conservant à cette notion de common decency son contenu équivoque. D’ailleurs Begout l’admet quelques pages plus loin en reconnaissant, “on le voit, il n’est pas simple de définir la décence ordinaire, dans les différents emplois qu’il en fait, Orwell n’en donne une définition univoque”. Ce qui entre pour le moins en contradiction avec ce qu’il écrivait plus haut. Ne lisant pas l’anglais, ni ne disposant d’une édition originale de ces Essais…, j’en resterais là. Cependant, là où Begout hésite, malgré tout, à faire de cette common decency un concept, Michéa, sans pour autant le formuler explicitement, n’a pas lui l’ombre d’une hésitation.
J’en viens donc au premier ouvrage publié par Jean-Claude Michéa, Orwell anarchiste tory. Dans ce livre Michéa revient plusieurs fois sur la common decency. Elle se trouve d’abord définie par “ce sens commun qui nous avertit qu’il y a des choses qui ne se font pas”. L’auteur ajoute plus loin qu’il s’agit également d’une “perception émotionnelle que quelque chose n’est pas juste”. Autre précision : “La common decency inclut donc aussi bien les formes modernes du sens éthique (…) que les formes d’obligation sociale plus traditionnelles, et les moins individualisées (…) Orwell y adjoint même explicitement des choses telles que l’affection, l’amitié, la bonté et même la politesse ordinaire”. Enfin citons deux dernières occurrences, plus ciblées : en premier lieu Michéa évoque l’intellectuel dont la “révolte, on le voit, n’a nullement pour ressort la common decency des prolétaires” ; quand la seconde traite du “principe de cette immense normalisation culturelle (qui) a pourtant été — Orwell l’avait prévu — la déconstruction méthodique de la common decency, devenue avec le temps, l’exercice obligé de toute pensée de gauche”.
Ceci posé, une rapide présentation de l’œuvre de George Orwell n’est pas inutile. Distinguons d’abord l’écrivain et romancier, l’auteur de deux livres essentiels, La ferme des animaux et 1984 qui n’ont pas besoin d’être commentés. J’y adjoins Hommage à la Catalogne : cet indispensable témoignage sur la guerre d’Espagne. Le reste de la production littéraire et romanesque d’Orwell n’a pas la même notoriété. Cela semble dommage pour Et vive l’aspidistra ! : un roman étonnant, surprenant pour qui ne connaîtrait de l’écrivain anglais que ses deux derniers et célèbres ouvrages. George Orwell, le penseur, essayiste et critique, est aujourd’hui mieux connu en France depuis la publication des Essais, articles et lettres. Ce second Orwell paraît plus problématique que le précédent. Pas tant le critique du totalitarisme — où ces deux Orwell d’ailleurs se confondent, (et au sujet duquel, mais avec d’autres moyens, l’auteur de 1984 figure, aux cotés d’Hannah Arendt parmi les penseurs ayant le plus contribué à la compréhension de ce phénomène) — que le penseur et vulgarisateur de cette fameuse common decency.
J’ajoute qu’il existe aujourd’hui comme une sorte d’interdit critique au sujet de George Orwell (et ceci dans des camps diamétralement opposés, ce qui ne manque pas d’intérêt). Je n’évoque nullement, il va de soi, les réponses à des articles visant à salir l’homme par la mention de propos prétendument délateurs. Orwell n’échappe cependant pas à la critique : quelques uns de ses essais et articles sont discutables, pour ne pas dire plus. La figure de “saint laïque” que d’aucuns font d’Orwell eut certainement indisposé l’auteur de La ferme des animaux (par delà, j’imagine, l’amusement d’une telle découverte).
Le livre de Bruce Begout, on l’a vu, aborde sous l’angle de la common decency l’œuvre de George Orwell. L’empathie dont fait preuve l’auteur ne l’empêche pas pour autant de porter sur l’écrivain anglais un regard contrasté. Begout apporte la précision suivante : “La common decency est la faculté instinctive (pour l’homme ordinaire) de percevoir le bien et le mal. Elle est même plus qu’une simple perception, car elle est réellement affectée par le bien et le mal”. Si pour Orwell, d’après Begout, les hommes ordinaires ne sont pas exempts de défauts (Orwell se plaint de leur apathie à défendre la liberté de la presse, de leur attentisme, ou de leur apolitisme), en revanche leurs qualités typiques (retour sur la common decency définie ici à travers “le sens du partage, l’entraide entre les gens simples, la méfiance vis à vis toute autorité”) les distingue fondamentalement, poursuit Begout, des intellectuels. D’où cette opposition chez Orwell, indispensable, entre la décence des gens ordinaire et l’indécence des intellectuels.
L’anti-intellectualisme de George Orwell ne se confond pas, précise Begout, avec celui de la droite réactionnaire accusant l’intellingentsia d’être responsable de la décadence morale et du déclin de la société. Orwell reproche aux intellectuels d’être coupés du monde de la vie quotidienne, de vivre dans le monde des idées, et donc de privilégier avant tout l’idéologie : ce qui les entraînerait à mépriser des valeurs aussi fondamentales que la liberté et la moralité avec comme conséquence dans les années trente l’enrôlement des intellectuels dans les partis totalitaires. Begout reconnaît cependant qu’Orwell “scrute cette continuelle mainmise de la “mentalité totalitaire” chez les intellectuels avec une persévérance qui frise parfois l’obsession”. Sans vouloir pour l’instant entrer dans le débat je résumerai ces propos par la formule suivante, d’Orwell : “Les gens ordinaires vivent toujours dans un monde de bien absolu et de mal absolu, monde dont les intellectuels se sont depuis longtemps détachés”.
Tout ceci n’est pas fondamentalement faux mais cette vision pour le moins schématique, des gens ordinaires et des intellectuels, n’échappe pas à la caricature, voire au manichéisme. C’est prêter plus de vertus aux dits “gens ordinaires” qu’ils n’en ont dans la réalité et c’est en retour forcer le trait en ce qui concerne les intellectuels, groupe hétérogène s’il en est. Que recouvre par exemple la terminologie “gens ordinaires” ? À lire Orwell on constate que cet emploi relève d’une géométrie variable. Même chose pour les intellectuels. D’ailleurs ne nous méprenons pas : le cursus universitaire du futur George Orwell, puis son activité d’écrivain et d’essayiste en font un intellectuel. Begout émet l’hypothèse que l’enrôlement d’Orwell dans la police birmane, puis, par la suite, la volonté du jeune écrivain de partager la vie (le temps d’une ou plusieurs expériences) des plus démunis participe d’une “stratégie d’abaissement” sur un mode expiatoire. Les éléments biographiques le confirment. On peut aussi évoquer quelque “haine de soi” durant ces années où l’écrivain Orwell se cherche encore. Celle-ci n’a cependant pas perduré contrairement à l’antienne anti-intellectualiste.
Sur un plan plus théorique, l’opposition entre “gens ordinaires” et “intellectuels”, formulée de la sorte, est-elle pertinente ? Pourquoi Orwell ici en l’occurrence ne raisonne-t-il pas en terme de classes sociales ? L’adhésion au totalitarisme concerne-t-elle les seuls intellectuels ? Il ne semble pas que de ce point de vue là la situation ait été sensiblement différente entre la Grande Bretagne et la France. Les centaines de milliers d’adhérents aux différents partis communistes européens ou ceux qui vinrent grossir les rangs des partis et des milices fascistes et nazies appartenaient en grande majorité aux “gens ordinaires”. On peut supposer (sinon on n’y comprend plus rien) qu’ils avaient par la même occasion abandonné toute forme de décence ordinaire, pour parler comme Orwell. Ce qui n’est pourtant pas complètement sûr en ce qui concerne les communistes à lire Michéa. Une seule certitude : Orwell a besoin de mettre en valeur la décence des “gens ordinaires” pour mieux l’opposer à l’indécence des intellectuels.
Dans son petit essai, Bruce Begout aborde la question de la moralité en notant que “parfois, Orwell cède trop facilement à la tentation d’instituer cette moralité ordinaire en critère de jugement absolu”. L’écrivain anglais, que ne choque nullement chez Henri Miller ou James Joyce la “vulgarité sexuelle”, devient plus que réticent à l’égard de James Hadley Chase. Citons ici l’un de ses articles les plus connus, Raffles et Miss Blandish : où le célèbre roman de Chase se trouve qualifié de “fascisme à l’état pur” en raison de son penchant à considérer comme normales et moralement neutres, voire admirables des scènes parfaitement immorales. Encore plus significatif, dans un article de la même année (1944) consacré à Salvador Dali, Orwell, commentant l’autobiographie du peintre (Le secret de la vie de Salvador Dali), parle d’un “livre qui pue” non pas pour les raisons qui ont fait exclure Dali du groupe surréaliste (sans parler de son ralliement ensuite au franquisme), mais, précise Orwell, parce qu’il est dirigé contre “la santé d’esprit et la simple décence (…) contre la vie elle-même”. Pour l’écrivain anglais “de tels individus sont indésirables, et une société qui favorise leur existence a quelque chose de détraqué”. Sans commentaires ! En toute logique Orwell aborde ensuite la question de “l’immunité artistique” qu’il illustre, en reprenant le discours des défenseurs de l’art (ce qui vaut lieu de condamnation), par “l’artiste doit être exempté des lois morales qui pèsent sur les gens ordinaires”.
Certes, Dali est indéfendable sur de nombreux aspects (nous savourons, rapporté par Orwell, le propos de Dali expliquant que la projection de L’Âge d’or fut interrompue par des voyous : on sait que ces “voyous” appartenaient en réalité à cette extrême-droite pour qui Dali aura plus tard quelque sympathie) mais pas sur ceux que George Orwell cloue au piloris : lesquels relèvent de l’activité fantasmatique et du geste créateur (même s’ils mettent en jeu des perversions ou s’appliquent à les décrire). J’en resterai là pour l’instant, quitte à y revenir dans la troisième partie. Citons quand même, vers la fin de l’article sur Dali, la phrase suivante : “Des phénomènes tels que le surréalisme (…) participent de la décadence bourgeoise (…) un point c’est tout” (ceci au nom, une fois n’est pas coutume, de la “critique marxiste”). Le P.C.F. à la même époque ne s’exprimait pas autrement.
Sans doute, ces deux articles cités, nous comprenons mieux les raisons de la focalisation d’Orwell sur cette “indécence des intellectuels” (ou prétendue telle). D’ailleurs Begout ne paraît pas tout à fait à son aise dans ce registre et préfère repartir sur des bases a priori plus solides : celle par exemple de la “répugnance populaire envers la violence et la perversion” dont il nous dit qu’elle “n’est pas le reflet d’un esprit petit bourgeois mais le témoignage d’une décence naturelle”. Nous voulons bien. Pourtant comment expliquer, du temps d’Orwell déjà, le succès auprès du public populaire d’une presse flattant et encourageant chez le lecteur des penchants plus ou moins conscients pour la violence et la perversion ? Il serait plus judicieux de remarquer, pour finir là-dessus, que la violence et les perversions sont les choses les mieux partagées du monde. Mais les uns (“gens ordinaires” disons) et les autres (les intellectuels, pour simplifier) n’y ont pas le même accès ou l’intègrent différemment. Les vaches sont bien gardées : l’art pour les seconds et la presse à scandale ou sensation (en y ajoutant aujourd’hui le people et la télé réalité) pour les premiers.
Cette common decency, pour revenir à Jean-Claude Michéa, n’apparaît qu’en une seule occasion dans L’enseignement de l’ignorance. En revanche, dans ses quatre livres suivants, Michéa revient souvent sur cette notion. En règle générale il reprend ou développe les définitions proposées dans Orwell anarchiste tory (que j’ai citées plus haut). Au fil des ouvrages Michéa tient à bien distinguer common decency et “idéologie du bien” (la seconde relevant d’un “catéchisme moralisateur” émanant d’une église ou d’un parti pour cautionner leur pouvoir) ; d’autre part il lui importe d’associer la common decency au principe de moralité proposé par Mauss dans son Essai sur le don (soit ici “ces capacités psychologiques, morales et culturelles de donner, recevoir et rendre”). On relève cependant une légère poussée de paranoïa quand, évoquant dans Orwell éducateur l’ouvrage de Mauss, Michéa avance que “les experts contemporains sont subventionnés par tous les centres de recherche possibles pour imaginer de nouvelles réfutations définitives de L’essai sur le don”. Voilà comment on utilise l’argent des contribuables ! C’est vraiment scandaleux ! Heureusement Pecresse et Sarkozy nous promettent de faire le ménage au CNRS et ailleurs. Ne désespérez pas Michéa !
Notre philosophe agrégé, dans Impasse Adam Smith, écrit les lignes suivantes : “Il n’est guère difficile de comprendre en quoi c’est cet attachement naturel à la common decency qui a permis à Orwell, à la différence de la plupart des intellectuels de son temps, de ne jamais éprouver la moindre fascination pour la volonté de puissance des partis totalitaires”. Revenons à la fin de l’année 1936. Alors que de nombreux intellectuels européens avaient pris position contre le stalinisme (pour s’en tenir à ce seul aspect), la question n’était pas encore réglée pour Orwell. Ses sympathies politiques allaient plutôt à la gauche anticommuniste, et plus particulièrement à l’Indépendant Labour Party (que l’on pourrait avec des nuances qualifier de “trotskiste”, et auquel Orwell finit par adhérer en juin 1938). C’est donc naturellement ou logiquement que George Orwell s’engage en décembre 1936 dans les milices du POUM (proche de l’ILP). Un moment il envisage rejoindre les Brigades Internationales (contrôlées par les communistes) pour être envoyé sur le front de Madrid, plus décisif à ses yeux. Orwell fera même des démarches en ce sens. L’évolution de la situation au printemps 1937 contribue à changer la donne. Dans un premier temps les journées de mai à Barcelone, puis l’interdiction du POUM le confronteront directement aux méthodes et pratiques staliniennes et l’inciteront à prendre définitivement son parti. Tout ceci se trouve narré et expliqué par Orwell dans Hommage à la Catalogne avec l’honnêteté intellectuelle qui caractérise son auteur. Les lecteurs d’Orwell ne sont donc pas sans savoir que la prise de conscience de l’écrivain anglais eu égard le totalitarisme stalinien date de sa participation à la guerre d’Espagne, et très précisément des journées de Barcelone. Ensuite Orwell n’a pas manqué de s’y référer. Ceci devait être rappelé. Les intellectuels qui durant les années trente se sont opposés parfois violemment aux staliniens l’ont fait pour de multiples raisons, mais certes pas (nous sommes d’accord) “par attachement à la common decency”, George Orwell compris. Revendiquer la chose pour Orwell relève d’un raisonnement a posteriori et d’une lecture tendancieuse de la biographie orweillienne.
Je viens d’évoquer “l’honnêteté intellectuelle” de George Orwell en me référant à Hommage à la Catalogne. Elle ne se trouve pas pour autant absente des articles que j’ai cités plus haut même si là mon désaccord est patent (en particulier autour de la notion “d’immunité artistique”). Cependant Orwell prend quelquefois à rebrousse-poil ses commentateurs les plus bienveillants ou les plus intéressés (lesquels auraient tendance à le figer dans une posture “politiquement correcte”, ou comme Jean-Claude Michéa à traduire cette dernière en terme de common decency). Les lignes suivantes, extraites de Hommage à la Catalogne, ne sont jamais citées que je sache par nos “orwelliens” (en tout cas pas par Michéa) : “Pour la première fois que j’étais à Barcelone, j’allais jeter un coup d’œil sur la cathédrale ; c’est une cathédrale moderne et l’un des plus hideux monuments du monde (…) À la différence de la plupart des autres églises de Barcelone, elle n’avait pas été endommagée pendant la révolution ; elle avait été épargnée à cause de sa “valeur artistique” disaient les gens. Je trouve que les anarchistes ont fait preuve de bien mauvais goût en ne la faisant pas sauter alors qu’ils en avaient l’occasion, et en se contentant de suspendre entre ses flèches une bannière rouge et noire”.
George Orwell, fondamentalement, n’a rien inventé. On savait avant lui que ce qu’il appelle “common decency”, à savoir la loyauté, l’honnêteté, la générosité, l’esprit d’entre-aide et la solidarité se portaient beaucoup mieux chez les “gens d’en bas” que ceux “d’en haut”. C’est autant un lieu commun que la traduction de travaux sociologiques ou de textes littéraires depuis le milieu du XIXe siècle. Cependant, même en reprenant la terminologie d’Orwell, en quoi, par delà les observations sociologiques qui s’y rapportent, sommes-nous aujourd’hui plus instruits ? Celles-ci recoupent par exemple celles faites depuis par Pierre Sansot, un sociologue atypique. Ces travaux qui ne sont pas sans intérêt n’ont pas eux la prétention d’en dire plus qu’ils ne relatent. Je n’en dirai pas autant de la common decency. Orwell n’est qu’à moitié responsable de l’utilisation qu’en fait Michéa. Pourtant, à lire ce dernier, on relève comme un écart entre la chose proprement dite et ce qu’elle produit comme effets. Il ne pouvait en être autrement lorsque, entre autres raisons, “gens ordinaires” vient se substituer à “prolétaires”. Ces qualités, relevées par Orwell — mais en insistant ici dans la liste proposée plus haut sur l’entraide et la solidarité — ne tournent pas à vide, ni ne se consument dans leur excellence quand elles viennent apporter de l’eau au moulin de la question sociale. C’est là qu’il faut reprendre et corriger Orwell en remplaçant “gens ordinaires” par “prolétaires”. Au moins ces qualités trouvent à s’exprimer à travers les diverses expressions d’un conflit social (la grève, les occupations, les manifestations, voire l’affrontement armé) opposant les “prolétaires” à la classe dirigeante (ou les gouvernés aux gouvernants).
Ce n’est là bien entendu que l’un des aspects de la question. Car aujourd’hui, en ce début de XXIe siècle, peut on encore ici parler dans les termes mêmes de George Orwell ? Ces mêmes qualités se retrouvent-elles nécessairement chez les dits “gens ordinaires” ? Orwell, me semble-t-il, apporterait de nos jours des correctifs à la notion de common decency. Sans doute accorderait-il plus d’importance au mouvement associatif, et à ces nouvelles classes moyennes qui en fournissent les plus importants bataillons. On imagine aussi qu’il prendrait davantage en considération la relation des “gens ordinaires” à la consommation en général, et aux médias en particulier. Et puis je n’exclus pas qu’il abandonnerait finalement la common decency : cette dernière se trouvant pour ainsi dire vidée de sa substance. Alors, pourquoi Michéa reprend-il dans les termes même d’Orwell cette notion de common decency dont le sens paraît pourtant se réduire telle une peau de chagrin ? Non content de la reprendre Michéa la tire même du côté d’un concept. Ce qui n’était pas le cas, j’insiste, avec Orwell et permettait donc plus de souplesse dans l’expression. Oui, pourquoi ?
Il y a plusieurs explications. D’abord parce que cette common decency se trouve au cœur de la pensée de Jean-Claude Michéa. Tout le reste en découle, y compris la large place prise au fil des ouvrages publiés par la réflexion sur le libéralisme (sous le double angle de sa “civilisation” ou d’un “retour sur sa question”). Mais pour que cet édifice puisse, du point de vue de son auteur, reposer sur de solides fondations tout autre ciment que la common decency n’eut pas fait l’affaire. Le lecteur en a été plus tôt informé à travers l’exemple d’Orwell. Michéa ne revient obsessionnellement sur la décence des “gens ordinaires” que pour l’opposer à l’indécence de ces “autres” (qui selon l’angle choisi se nomment possédants, classes supérieures ou intellectuels). Ce qu’il faut bien appeler une “conception du monde” chez lui s’en ressent. Et celle que nous expose et propose Michéa n’a pas grand chose à voir avec l’émancipation (du moins telle qu’elle se trouve défendue par l’auteur de ces lignes). Mais n’anticipons pas, nous aurons tout le loisir d’y revenir.
Dans La double pensée Michéa apporte quelques éléments biographiques très instructifs. Né dans une famille de militants communistes (son père, Abel Michéa, est un journaliste sportif réputé), le jeune Jean-Claude rejoint comme il va de soi les organisations de jeunesse du P.C.F. En 1967, l’année du début de ses études de philosophie à la Sorbonne, Michéa passe dans le camp gauchiste. Deux ans plus tard il retourne au P.C.F. (le fait n’est pas courant et mérite d’être souligné). Il quittera finalement le Parti en 1976. Michéa n’est pas sans conserver quelque nostalgie de ce passé dans son évocation des militants communistes rencontrés pendant cette dizaine d’années. Par ailleurs il dit préférer avant tout “les plaisirs du football, de l’amitié et des plages montpelliéraines”. Notre auteur s’excuserait presque d’avoir écrit huit ouvrages. Un agrégé de philosophie certes (comme l’indiquent ses “quatrième de couverture”), mais qui a su conserver une fibre populaire. C’est du moins l’image que Michéa dans plusieurs entretiens tient à donner de sa personne.
Dans la préface de Impasse Adam Smith, le premier mot à apparaître en italique (et avec une majuscule, s’il vous plaît !) est Peuple. Conservons le mot pour faire état de griefs permanents chez Michéa concernant la façon dont on traite (ou maltraite) le peuple : soit dans la façon de le décrire, ou celle de le “mettre en concept”. Tout d’abord Michéa se plaint que “les élites intellectuelles et médiatiques” caricaturent les “gens ordinaires” en “beaufs” et en “Deschiens”. Guignol a changé de camp, nous dit-il, aujourd’hui ce sont les élites qui se moquent du peuple. Le personnage du “beauf”, pour lui répondre, est devenu aujourd’hui un type à part entière dans une tradition caricaturale initiée par Daumier. Le beauf existe, chacun d’entre nous l’a rencontré. Cabu a su “croquer” ce type et lui a donné ce nom (ce qui n’est pas rien !). Ce terme désigne un homme plutôt vulgaire, aux idées étroites et aux goûts discutables, rempli de préjugés, peu tolérant, peu cultivé et parfois le revendiquant, généralement chauvin et raciste, le tout baignant dans une certaine autosatisfaction. J’ajoute qu’on l’imagine plutôt amateur de football, et passant de préférence ses vacances sur les plages des bords de mer. Plus en amont, le terme BOF (beurre-œufs-fromage), qui se rapporte à une catégorie de petits commerçants, et par extension au poujadisme pourrait lui être associé. D’ailleurs la définition proposée un peu plus haut rend la catégorie “peuple” très extensible puisque elle désignerait également de larges secteurs de la petite bourgeoisie, voire des classes moyennes (anciennes). Ne voir là qu’un effet de la malignité des “élites” à se “moquer du peuple” paraît manquer du plus élémentaire sens de l’humour. J’espère que lors de l’entretien accordé en 2000 à Charlie-Hebdo (repris et remanié dans Impasse Adam Smith) Michéa eut l’occasion hors micro de se plaindre de l’immense tort fait par Cabu auprès des “gens ordinaires”.
Les Deschiens n’appartiennent pas à l’univers de la caricature. C’est plutôt dans un registre poétique qui tient à la fois du cirque, de Jacques Tati, des chansons populaires ou de l’art brut qu’il faut replacer ce cycle. Il y a plus de tendresse que de moquerie dans le regard que l’on porte sur les personnages des Deschiens. L’incapacité de Michéa, pourtant hérault auto proclamé des “gens ordinaires”, à réfléchir un tant soit peu sur le concept de “culture populaire” parait confondante. À moins que pour lui celle-ci se trouve réduite aux seuls sports (que Michéa aime tant) : c’est dire !
Dans tous ses ouvrages notre philosophe ne manque pas de faire référence et allégeance au populisme. Le plus souvent pour se plaindre d’un détournement de sens (ou d’une manipulation ou désinformation qu’il impute aux intellectuels, ou aux “médias officiels”, voire “aux ateliers sémantiques des politologues”). Michéa pousse le bouchon un peu loin dans Orwell éducateur en allant jusqu’à écrire que le mot populisme aurait été “intégralement falsifié sur ordre (sic) par les politologues et les néojournalistes de l’ordre établi”. Mais qui donc aurait donné un tel ordre ? Michéa en dit trop ou pas assez : nous voulons des noms ! Il y aurait-il un chef d’orchestre clandestin ? Inversement Michéa prétend que le “western hollywoodien classique” (genre qu’il semble priser) exprime “quelque chose encore des valeurs de ce fier populisme américain et de sa common decency”. C’est curieux, nous ne l’avions pas remarqué. Michéa aurait plus avisé, quitte à prendre un exemple, de citer le courant folk singer (ou protest singer) en général, et Woody Guthrie en particulier.
Une première constatation. On peut difficilement nier que le mot “populisme”, qui à l’origine désignait des courants politiques américains ou russes de la seconde moitié du XIXe siècle se réclamant du peuple (mais également une école littéraire apparue en France au début des années 20 qui se proposait de dépeindre avec réalisme la vie des gens du peuple), a changé de signification. Michéa explique ce “glissement de sens” contemporain (non sans avoir indiqué préalablement que populisme désignait “l’ensemble des idées et des principes qui, en 1968 et dans les années suivantes, avaient guidé les classes populaires dans leurs différents combats pour refuser, par avance, les effets (…) destructeurs de la modernité capitaliste”) par le changement de cap opéré par le Parti Socialiste en 1983. Nous avons quitté le registre paranoïde de Orwell éducateur et la discussion redevient possible. Ne pouvant plus se situer sur le terrain de la “rupture avec le capitalisme”, poursuit Michéa, il fallait bien trouver quelque “idéal de substitution”. L’antiracisme, ajoute-t-il, y répondra principalement (aidé par “l’indispensable installation d’un FN dans le nouveau paysage politique”, celle-ci résultant de “l’institution, le temps d’un scrutin, du système proportionnel) : cette conjonction favorisant dans les “médias officiels” une traduction en terme de populisme”.
Cette analyse n’est pas complètement fausse (même si la forte montée du Front National ne s’explique pas fondamentalement par la duplicité tactique de Mitterrand : le maintien pendant vingt ans du FN à cet étiage électoral d’environ 15 % prouve si besoin était qu’il faut chercher d’autres explications) mais passe à côté de l’essentiel. Pourtant, évoquant le FN (signalons en passant que la référence à l’extrême-droite est quasiment absente des ouvrages de Michéa) notre philosophe prend en compte l’un des deux aspects de la question. Il lui manque l’autre, le plus important, à savoir la sensible perte d’influence du P.C.F. durant les années 80 et 90 : une perte d’influence à mettre parallèlement en relation avec l’émergence d’un fort FN (du moins sur le plan électoral). On sait que dans plusieurs bastions communistes (d’un électorat populaire plutôt ouvrier) de très nombreux électeurs communistes reportèrent leurs suffrages sur le FN. Cette donnée incontestable (et vérifiable du point de vue de la sociologie électorale) fut contestée par ceux que heurtait au plus fort de leurs convictions une pareille réalité. Le populisme, j’y reviens à travers la traduction d’un certain nombre de phénomènes contemporains, n’est en tout cas pas univoquement comme le prétend Michéa le mot derrière lequel les élites et consort entendent dénigrer les gens du peuple de la manière la plus maligne.
Je propose la définition suivante. On appelle “populisme” les courants de pensée apparus vers la fin du XXe siècle dans un contexte de mondialisation accélérée qui, disant parler au nom du peuple ou affirmant vouloir en défendre les valeurs, excipent des légitimes inquiétudes des classes populaires devant pareille évolution pour leur proposer une médecine et des remèdes pires que la maladie. Le populisme, d’une part participe de la liquidation du prolétariat comme sujet émancipateur visant à l’abolition des classes sociales ; d’autre part, il représente pour les élites converties à la mondialisation un commode épouvantail brandi le cas échéant pour fustiger la défense non moins légitime des avantages acquis des salariés. Cette dernière précision s’avère bien entendu nécessaire si l’on l’on prend en considération la tendance chez nos gouvernants, et plus encore chez les “experts” qui les inspirent d’amalgamer toutes les formes de dissensus qui remettraient en cause le consensus dominant (ou décrit comme tel) : de l’expression démocratique des salariés dans les conflits sociaux aux questions raciales ou religieuses.
Bruce Begout reconnaît qu’il “y a manifestement dans la pensée politique d’Orwell des penchants au populisme : sa critique des élites non-patriotiques et internationalistes, sa virulence contre le monde politique coupé du peuple, son éloge des petites gens et de leur honnêteté spontanée ; tous les ingrédients sont là pour engendrer une forme diffuse de démagogie radicale-socialiste sur la défense des petits contre les gros”. Cependant, au risque de se contredire, il affirme dans le même mouvement que “la théorie de la décence ordinaire” constitue le meilleur antidote contre toute forme de populisme. Cette théorie (si on veut bien l’appeler telle) qui la détient ? Pas les “gens ordinaires” certes. D’ailleurs, en reprenant l’une des définitions proposées, la common decency désigne “un sens moral inné”, quelque chose de naturel donc, qui va de soi. Rien d’une théorie. Jusqu’à preuve du contraire les théoriciens de la common decency s’appellent Orwell, Michéa, Begout, pour ne citer qu’eux.
Les mineurs de la vallée du Jui, en répondant une première fois en 1990 au discours populiste de Ion Ilescu, c’est-à-dire en venant casser du hooligan ou de l’étudiant dans les rues de Bucarest, manquaient du sens le plus élémentaire de common decency. On peut certes parler ici de manipulation mais Ilescu n’eut pas trop à forcer son talent pour aboutir à un tel résultat. Ce “sens moral inné” n’avait pas auparavant empêché une bonne partie des “gens ordinaires” de soutenir les régimes stalinien et hitlérien. On se souvient que les opposants politiques en URSS, mais aussi les dissidents, les déviants ou tous ceux qui ne se retrouvaient pas dans la ligne étaient traités “d’ennemis du peuple”. Certains (en Allemagne, ou dans les anciennes “démocraties populaires”), à qui pour les plus âgés on ne pourrait reprocher que leur passivité durant les années nationales-socialistes ou staliniennes, regrettaient, ou disent regrettent l’un ou l’autre de ces régimes en arguant du fait qu’en “ce temps-là la vie était plus décente” (sous entendu la vie matérielle) : un discours entendu au mot près, et qui n’a rien d’exceptionnel. Et oui, le même mot peut dire une chose et son contraire. Ou peut-être pas, après tout…
On le constate : la mayonnaise, cette common decency, a du mal à prendre. Pour lui donner plus de consistance, Jean-Claude Michéa va donc reprendre l’opposition faite auparavant par Orwell entre la décence des “gens ordinaires” et l’indécence de ceux que notre philosophe qualifie le plus souvent par “les intellectuels” (qui sous sa plume peut aussi bien désigner “les intellectuels de gauche”, “l’extrême-gauche du libéralisme” ou “la sociologie d’État”). On distingue deux axes critiques dans cette volonté ici chez Michéa de mieux faire ressortir l’indécence des seconds (en l’opposant il va de soi à la décence des premiers). Le premier axe reprend grosso modo le point de vue d’Orwell en matière de morale, de transgression ou de “libération des mœurs” en l’adaptant aux réalités de notre contemporainéité. J’en parlerai plus longuement dans la troisième partie. Toute réponse circonstanciée serait pour l’instant prématurée dans la mesure où elle tend à dépasser le propos de Michéa pour aborder une thématique plus globale et plus complexe.
Le second axe critique tient largement compte des réalités “sociétales” (ou prétendues telles) du monde contemporain, même si Michéa repère ici et là chez Orwell les prémices de ce que l’auteur de 1984 appelle “le crime moderne”. Dans L’enseignement de l’ignorance Michéa consacre plusieurs pages aux questions que les médias classent sous les rubriques “délinquance”, “intégration”, “quartiers sensibles”, “insécurité”. Là où d’autres évoquent des “barbares” ou la “racaille”, Michéa se réfère lui à la Caillera (soit “les bandes violentes, surgies sur la ruine politiquement organisée des cultures populaires, et qui règnent par le trafic et la terreur sur les populations indigènes et immigrées des quartiers que l’État et le capitalisme légal ont désertés”). Une telle définition charge quelque peu la barque. Mais acceptons-en le principe sans pour autant souscrire à tous les détails du tableau. S’ensuivent chez Michéa des remarques justifiées sur l’intégration de cette “caillera” au système capitaliste en terme de consommation, business et symbolisation du pouvoir. Cependant, ces précisions apportées, un tel tableau dans son ensemble renvoie pour l’essentiel à l’univers du crime organisé. À la différence près que le “milieu”, ou plus sûrement un “nouveau milieu” aurait investi les quartiers dits sensibles, ceux où l’État se retire (du moins en partie). Le lecteur qui s’attendrait à trouver ensuite des éléments permettant de comprendre le pourquoi et le comment de cette situation en sera pour ses frais. En revanche on voit mieux où Michéa veut en venir. Partant du fait que la “caillera” est “parfaitement intégrée au système qui détruit la société”, Michéa ajoute dans la foulée : “C’est évidemment à ce titre qu’elle ne manque pas de fasciner les intellectuels et les cinéastes de la classe dominante, dont la mauvaise conscience constitutive les dispose toujours à espérer qu’il existe une façon romantique d’extorquer la plus value”.
Le plus grave n’est pas tant que ce genre de charabia ait été écrit et publié (il en existe bien d’autres !), mais que des lecteurs pourtant pas trop bien disposés à l’égard du monde tel qu’il va croient reconnaître dans les lignes précédentes quelque écho critique. Il n’y a aucun lien logique entre les deux phrases (le “à ce titre” l’illustre pour ainsi dire), et il paraît inutile de “déconstruire” la seconde : son ridicule saute aux yeux de qui sait lire. À ce sujet la mention ici de “cinéastes de la classe dominante” (appelés ainsi en raison de leur fascination pour la dite “caillera”) ne manque pas de sel lorsque l’on connaît par ailleurs l’admiration de Michéa pour le cinéma hollywoodien et ses cinéastes (dépositaires d’un “art populaire” les préservant de facto de toute appartenance à la “classe dominante”). On aura compris que quand Michéa brocarde les intellectuels et les artistes ceux-ci appartiennent sans barguigner à la classe dominante tandis que dans le cas contraire (groupe limité pour les seconds au seul exemple hollywoodien) il n’en est rien. Le lecteur commence à connaître la chanson. Mais il reste encore plusieurs couplets.
Ces grandes lignes tracées, Jean-Claude Michéa concentre son tir sur ce qu’il appelle “la sociologie d’État” : la principale coupable, puisque légitimant en quelque sorte la fascination des intellectuels et artistes pour les délinquants. Passer ainsi dans le même paragraphe du mot “caillera” à celui de “délinquant” comme si de rien n’était n’a rien d’innocent. Pour l’heure Michéa entend éclairer son lecteur sur deux procédés qui permettent à la “sociologie d’État” de mieux faire passer la pilule. Tout d’abord il l’accuse de revêtir le délinquant moderne de la tunique du bandit d’honneur de jadis : une opération gratifiante sous l’angle des prestiges de la rébellion et de la révolte morale. Une indication amusante. Michéa ne cite ici que les seuls noms de Harlem Désir et Félix Guattari. Ce qui prouve que chez lui la notion de “sociologie d’État” s’avère particulièrement extensible.
Le second procédé, celui de l’élaboration par la dite “sociologie d’État” d’un paradigme du délinquant moderne, consiste à justifier l’existence de la délinquance par “l’effet mécanique de la misère et du chômage”, et par conséquent de la déligitimer (ne pas la reconnaître telle). Là nous sommes en terrain connu. L’argument a déjà servi : c’est même devenu le fond de commerce de certains “penseurs” ou “médiatiques”. Cette argumentation s’est retrouvée au cœur des campagnes électorales de 2002 et 2007. Alain Finkielkraut s’en fait l’infatigable propagandiste depuis de longues années. Michéa tient à nous faire savoir que ce paradigme a “d’abord été célébré dans l’ordre culturel” avant de trouver “ses bases pratiques dans la prospérité économique des Trente glorieuses”. Et de citer un dénommé Charles Szlakmann, lequel aurait fourni toutes les données statistiques nécessaire dans son ouvrage La violence urbaine publié en 1992. Nous avouons ne pas connaître un si remarquable penseur. Dans ce livre (celui d’un historien et journaliste), sous titré “à contre courant des idées reçues”, l’auteur avance que ces phénomènes de violence ne sont pas pour lui associés au chômage et à la pauvreté mais relèvent du mépris de l’autre, particulièrement du plus faible. Malheureusement ce livre décisif n’a pas trouvé de lecteurs en 1992, et encore moins de commentateurs (si ce n’est le sagace et vigilant Michéa). Nul doute que la “sociologie d’État”, compte tenu des moyens démesurés dont elle dispose, s’est évertuée à établir un mur de silence autour de cette démonstration impitoyable de la vacuité des thèses de la dite sociologie sur la délinquance.
Enfin, pour terminer sur ce long paragraphe de L’enseignement de l’ignorance Michéa nous informe que “le développement de la délinquance moderne”, d’abord considéré par la sociologie officielle comme “un pur fantasme des classes populaires” (il ne cite aucun nom étant bien entendu dans l’impossibilité de trouver un auteur l’ayant prétendu : c’est pur fantasme chez Michéa), s’apparente selon lui à une “procédure gagnante pour le capitalisme” des lors qu’on le présente “comme un effet conjoncturel du chômage”. Et pourquoi donc ? D’abord cela conduirait à présenter la “reprise économique” pour la clé principale du problème. La relation de cause à effet nous échappe. Ensuite Michéa nous entretient de “la logique même du capitalisme de consommation” qu’il relie aux “conditions symboliques et imaginaires d’un nouveau rapport des sujets à la Loi” sans pour autant répondre à la question. Nous en resterons donc là. Pas tout à fait puisque, pour conclure, Michéa tient à illustrer une dernière fois la “fascination exercée sur les intellectuels bourgeois (…) par la figure du mauvais garçon” en citant Chalamov et son ouvrage Le monde du crime. Ici la référence en terme de droits communs (qui possède encore plus de force dans L’archipel du Goulag de Soljénitsyne) paraît déplacée du point de vue de la fascination indiquée par Michéa. Elle renvoie chez Chalamov à l’une des fonctions du monde totalitaire. Il paraît difficile de comparer ce qui est incomparable. Mais c’était en passant une manière d’opposer le vécu d’un Chalamov à la science du Collège de France. Une opposition dont la pertinence n’échappera à personne.
Les livres suivants de notre philosophe reprennent la même antienne. Sinon dans L’empire du moindre mal Michéa hasarde une hypothèse psychologisante : “le besoin de chercher à tout prix une explication purement sociologique” étant imputée à une faillite personnelle ou philosophique. Nous apprenons que l’imaginaire de nos sociologues est “structuré par une double fascination pour l’idéal de la science et un spinozisme simplifié, et pas une influence souterraine des sensibilités luthériennes et jansénistes” (sic). Plus sérieusement, nous comprenons mieux pareille hostilité à la dite “sociologie d’État” en général, et de Bourdieu en particulier quand Michéa, sans trop nous surprendre, en vient à défendre mordicus la notion de “mérite” (critiquée par Bourdieu). Nous avons là l’un des noyaux durs de la pensée michéenne qui renseigne mieux sur les présupposés de notre philosophe que ses explications fantaisistes ou cuistres sur “l’imaginaire des sociologues”. On pourrait d’ailleurs retourner contre lui, à des fins d’explication psychologique, son argumentation de la même manière qu’il en use avec ses habituelles têtes de turc. Il ne faudrait cependant pas croire que Michéa met tous les sociologues dans le même panier de linge sale de la “sociologie d’État”. Il en est au moins un, Paul Yonnet, qui trouve grâce à ses yeux. Il se trouve que Michéa et Yonnet sont tous deux sur la même longueur d’onde.
Plus fondamentalement (et ici un recul historique s’impose), Michéa nous devait quelque explication philosophique de la thématique traitée depuis plusieurs pages. Dans Orwell éducateur il reproche aux Lumières (et ce partant à “toute sensibilité progressiste”) de ne pas avoir “su penser le Mal autrement que comme privation”. Donc, “pour un esprit moderne”, le “mystère métaphysique du crime” ne peut trouver d’explication qu’à travers les “effets du chômage, de l’ignorance, des coups reçus pendant l’enfance”, etc., etc. Nous revenons par un autre biais aux propos cités précédemment par Michéa (et d’autres). Ce dernier ajoute cependant : “Cette forclusion moderne de la question du Mal n’interdit pas seulement de poser le problème éthique sur des bases sérieuses, dans la mesure où elle revient toujours, d’une manière ou d’une autre, à évacuer la part d’implication personnelle du sujet dans ses actes (part toujours pensée, dans un discours de la Cause Excusante, comme un sentiment illusoire et mystification idéaliste)”.
Je répondrai en deux points : d’abord sur la première partie du propos de Michéa, puis sur la seconde, plus importante. L’auteur de ces lignes, ancien travailleur social (et ayant de surcroît principalement travaillé en milieu psychiatrique, mais également en maison d’arrêt) a été durant sa vie professionnelle confronté en permanence à ces “effets”. L’histoire d’un sujet, en l’occurrence, permet de comprendre comment celui-ci en est arrivé là : à venir consulter dans un service social ou de psychiatrie, ou se retrouver en prison. C’est justement en décryptant et et en prenant compte ces différents éléments que les professionnels pourront intervenir en aval en essayant de trouver, avec l’aide du sujet, des réponses adaptées à ses difficultés, à sa situation ou aux symptômes et troubles présentés. Il s’agit bien entendu d’une règle générale. Mais même en considérant chacune des exceptions celles-ci élargissent plutôt la palette de ces “effets” qu’elles ne contredisent les observations générales induites par la biographie. Tout comme il est avéré (mais qui prétend le contraire !) que le chômage, l’ignorance, la maltraitance et l’humiliation ne conduisent pas nécessairement à la délinquance. C’est même le cas de la grande majorité des personnes qui s’y trouvent, ou qui y ont été confrontées. Ceci ressort d’une évidence. En revanche, nier la réalité de ces “effets”, ne pas reconnaître qu’ils puissent constituer même l’ébauche d’une “explication” (d’ailleurs Michéa et consort substituent là par commodité le mot “excuses”) porte un nom : c’est de l’idéologie. Une fois de plus inversons la question. Pourquoi refuser de voir et d’admettre ce que les professionnels de la profession observent et constatent à longueur d’année ? Un reportage de TF1, un article de Finkielkraut, un discours de Sarkozy, ou les résultats d’un sondage d’opinion (publié de préférence au lendemain d’un “crime crapuleux”) auraient-ils raison de l’observation et du travail sur le terrain, avec les intéressés ? Nous avons bien entendu notre idée sur la question, et l’exposerons quand il le faudra.
Le second point paraît plus fondamental, philosophiquement parlant. L’argumentation de Michéa, en terme d’implication personnelle (souligné par lui), ou sa logique si l’on préfère, vaut bien entendu pour un penseur, un philosophe, un écrivain, un artiste, un révolutionnaire, enfin pour tous ceux, intellectuels, créateurs ou militants politiques, dont l’activité, la création, les écrits portent très justement la marque de cette implication personnelle. D’autant plus, il convient de le préciser, qu’elle pose la question de la responsabilité de ceux-ci et de ceux-là. Mais ce qui est vrai et vérifiable ici n’a plus la même signification dés lors que l’on quitte le chemin balisé du sujet conscient et responsable. C’est dire que la notion de responsabilité ne peut être ailleurs invoquée dans les mêmes termes. Autant, en se référant à un sujet conscient et responsable, la question morale posée par Michéa est justifiée ; autant elle prend ailleurs un caractère idéologique pour évacuer ou refouler toute explication mettant en procès le monde dans lequel nous vivons. Car c’est la question essentielle, et sur laquelle achoppent les Michéa et consort : cette société, pour le dire trivialement, a les délinquants qu’elle mérite.
On sait que cette focalisation sur le “mal” n’est pas nouvelle. Depuis longtemps elle exprime la position de ceux qui, excipant d’une “mauvaise nature de l’homme” (encore plus mauvaise quand on descend dans les classes inférieures), s’efforcent d’accréditer le fait que toute volonté de transformer le monde s’avère non opératoire et inutile de part cette “mauvaise nature de l’homme” et ce “mal” organiquement liés à la condition humaine. Cela ne constitue pas fondamentalement une nouveauté d’entendre ce discours repris par une partie de nos élites intellectuels ou du personnel politique (la gauche ayant ici rejoint la droite même si elle donne l’impression d’avoir le cul entre deux chaises). Rien de plus normal chez ceux dont les positionnements philosophique et politique s’accordent sur la manière d’aborder cette question, celle du “mal”. Laquelle, faut-il le préciser, ne connaît pas de meilleure réponse en matière de délinquance que celle de la répression : protéger la société en punissant sans état d’âme et de manière exemplaire des sujets délinquants tenus responsables de leurs actes. Michéa, qui partage en amont ces analyses et constats, ne va pas pourtant jusqu’au bout des conséquences que les premiers réclament et nécessitent. Pourquoi le plus gros du chemin fait, s’arrête-t-il au moment de conclure ? Ce n’est pourtant pas que je sache par prudence flaubertienne. D’un point de vue moral nous pourrions le qualifier de “faux cul”. Allons, encore un petit effort camarade Michéa ! Cela coûte peut-être la première fois. Mais vous verrez, d’aucuns vous le confirmeront (parmi nos ex : communistes, gauchistes, radicaux), comme on se sent soulagé, après !
Aux habituels griefs de Jean-Claude Michéa (sur la question scolaire et la délinquance) viennent s’ajouter ceux concernant le rapport à l’immigration et aux sans-papiers. Ici l’auteur concentre son tir sur Réseau-[Éducation-]Sans-Frontière. Il ne le fait pas frontalement comme un vulgaire politicien de droite s’insurgeant contre les entraves à l’application de la politique de l’immigration votée par une majorité de Français. Dans l’analyse michéenne R[E]SF devient l’un des agents indirect de ce nomadisme induit par les “nouvelles formes capitalistes du déplacement et de la force de travail”. Sur ce terrain sensible on découvre un Michéa pris entre le désir de se lâcher et une certaine prudence (de ne pas trop donner de prise à l’adversaire).
Une dernière donnée, pour compléter le tableau esquissé jusqu’à présent, concerne la famille. Il peut paraître étrange de trouver sous la plume d’un penseur se disant volontiers “radical” (selon la définition donnée par Marx) des propos à ce point alarmants sur la délitescence de la famille. Certes Michéa n’arbore pas son familialisme à la boutonnière. On remarque qu’il s’abstient de citer ici Engels (convoqué dans d’autres pages sur son analyse du lumpenprolétariat) qui a pourtant écrit un ouvrage classique sur la question. Mais, histoire de retomber comme d’habitude sur ses pieds, Michéa rend le capitalisme responsable de cette délitescence. Cependant la manière que prend cette défense et illustration de la famille (en opposition au nomadisme et au monde sans frontière des “penseurs de l’extrême gauche”) nous remet fâcheusement en mémoire une certaine formule : “Je préfère ma fille à ma nièce, ma nièce à ma cousine, ma cousine à ma voisine, etc.” Ne nous méprenons pas ! Michéa ne va pas chercher ses références chez Le Pen mais dans la psychanalyse (en précisant qu’il s’agit là du “dernier Michéa” : celui de L’empire du moindre mal ou de La double pensée, davantage branché sur certaines théorisations psychanalytiques). Les militants de cette “extrême-gauche libérale” (soit la détestation des détestations pour Michéa), que tout oppose à “l’homme œdipien”, ne peuvent que renvoyer (les “progrès du capitalisme aidant” précise l’auteur) au “meurtre du père et à la soumission parallèle à une mère dévorante”. D’ailleurs cette référence matriarcale n’est pas sans rencontrer un certain succès auprès du “dernier Michéa” : elle se trouve régulièrement associée à “l’inconscient de la gauche extrême”. Qui eut dit que la common decency menait à une certaine idée de l’ordre symbolique ! Mais laissons là la psychanalyse pour l’instant.
L’argumentation de Jean-Claude Michéa prend parfois un aspect boutiquier (la boutique philosophique contre la boutique sociologique) qui l’entraîne à tenir sur la seconde les propos caricaturaux que l’on a relevés. La mention réitérée de livre en livre d’une “sociologie d’État” ou “sociologie officielle” — dont Michéa exclurait tout sociologue qui ne chercherait pas d’excuses aux délinquants, ou qui remettrait en question le manque d’autorité à l’école ou ailleurs, ou qui ne chercherait pas à justifier la présence d’une immigration irrégulière sur le sol national, ou qui se plaindrait du délitescence des liens familiaux — finit par lasser. Ceci n’a rien d’original : c’est même devenu l’un des pont-aux-ânes de certains penseurs médiatiques. N’appartenant ni à l’une ou l’autre de ces “boutiques” je répondrai d’abord de manière générale sur la sociologie avant de m’attarder plus longuement sur un événement étrangement absent des derniers ouvrages de Michéa, à savoir les émeutes de l’automne 2005 dans les banlieues françaises.
Dans sa critique de la sociologie Michéa aurait été plus inspiré de se référer à un numéro de la revue Lignes intitulé “Crise et critique de la sociologie” (publié en 1999), et en particulier à l’article de Henri-Pierre Jeudy (sociologue et philosophe, il faut le souligner), “L’esthétisme des sciences sociales”. Comme le précise Jeudy : “La violence critique qui semblait inhérente à l’écriture sociologique elle-même, qui tirait sa puissance d’une volonté, désormais tenue pour idéologique, de changer radicalement la société, a perdu son sens utopique, la sociologie affichant sa fonction d’aide à la gestion de la collectivité ou son rôle thérapeutique par la compréhension et la production du lien social”. Le rôle, étant alors assigné à la sociologie, relevant d’une meilleure gestion de la société. À vrai dire Michéa n’aborde nullement la sociologie de ce point de vue critique. On imagine également que la revue Lignes n’est pas sa tasse de thé. La critique michéenne (si l’on peut dire) vise davantage Laurent Mucchielli et le courant auquel ce sociologue appartient, qui, contrairement à ce qu’affirme Michéa, ne se situe pas en “pôle position” dans le domaine des sciences sociales. Il paraît certain que les travaux de Mucchielli et ses ses amis — lesquels tendent à s’inscrire en faux contre l’opinion dominante (que les médias influents, des intellectuels décomplexés, et des politiciens intéressés façonnent à coup de fausses évidences) en matière d’insécurité, de violence à l’école et d’association entre immigration et délinquance — insupportent particulièrement Michéa. Pour y voir un peu plus clair faisons un détour par les émeutes de l’automne 2005.
Dans un texte écrit en janvier 2006 (“Remarques sur les émeutes de l’automne 2005 dans les banlieues françaises”), j’essaye de faire la part des choses entre une analyse en prise directe sur ces émeutes et celle que m’inspire cet événement (sous toutes ses occurrences) dans le contexte plus global de notre monde contemporain. Si en premier lieu j’entends donner raison aux émeutiers (en incluant le soutien aux personnes inculpées et la demande d’amnistie pour celles faisant l’objet d’une condamnation), en second lieu ma réflexion devient plus problématique. Dans le premier cas je l’exprime ainsi : “Les jeunes émeutiers, majoritairement noirs et arabes, par delà les discriminations raciales exprimaient à travers leur révolte le sentiment plus ou moins diffus de la plupart des habitants des quartiers dits sensibles, à savoir le refus d’une “vie de merde” dans ces marges de la société les plus directement confrontées à la dégradation des conditions d’existence. Ces mêmes habitants le traduisaient à leur façon quand, tout en se plaignant de l’incendie de leur véhicule ou de la destruction de l’école du quartier, ils disaient comprendre les émeutiers”. Dans le second cas il me fallait me confronter au terme récurrent d’intégration. Ici mon analyse pourrait rejoindre celle de Michéa quand, pour ma part, j’évoque une ”intégration réussie” en précisant : “Les “jeunes de banlieue” sont aussi les enfants de ce monde. Celui du “bonheur dans la consommation”, de TF1 et de M6, des séries américaines, des fast food, de la bagnole, de la pub, des marques. le rap représente un bon indicateur de cette ambivalence. D’un côté nous sommes confronté à une parole de révolte, celle-là même qui s’exprime en actes durant l’automne 2005 ; de l’autre nous nous déplaçons dans un univers célébrant sans barguigner le règne de la marchandise”.
C’est vouloir reconnaître que le “jeune de banlieue” peut être ceci et cela : un émeutier et un “consommateur moderne”. Il vaut mieux parler d’ambivalence que de contradiction pour comprendre les raisons ici de la révolte et là de soumission au monde de la marchandise. Il y a donc un double écueil à éviter : magnifier la première sans tenir compte de la seconde limite l’exemplarité à la seule expression idéale du phénomène ; se focaliser sur la seconde laisse la porte ouverte à toutes les interprétations qui, en terme de prise en otage des quartiers par les caïds de la drogue ou de manipulation islamiste, se sont exercées au déni de réalité tout au long de ces semaines d’émeutes.
C’est d’ailleurs là que nous retrouvons Michéa. Son long paragraphe de L’enseignement de l’ignorance, “La caillera et son intégration”, représente en quelque sorte les prémices de ce que d’aucuns diront, écriront, et prétendront pendant et après les émeutes de l’automne 2005. Certes Michéa peut toujours, pour établir un lien historique entre l’ancien lumpenprolétariat et l’actuelle caillera reprendre une citation connue (et discutable) de Marx et une autre moins connue (mais encore plus discutable) d’Engels. Reconnaissons cependant que Michéa ne fait pas volontairement l’amalgame entre jeune de banlieue et délinquant. En cela il s’avère plus prudent que Jaime Semprun (auquel Michéa, à la fin de l’ouvrage précité, rend un hommage mérité car sa démonstration se trouve en partie empruntée à L’abîme se repeuple de Semprun) qui lui appelle “barbare” la “jeunesse sans avenir des cités”.
Ceux qui, à l’instar des Finkielkraut [Alain Finkielkraut n’est ici cité, une fois de plus, que comme philosophe et penseur incarnant plus que d’autres la “tendance à l’œuvre” auquel Michéa apporte sa contribution dans les registres que je viens de relever. On peut être totalement en désaccord avec Finkielkraut sans pour autant le mépriser (comme nous pourrions le dire, parmi de très nombreux exemples, d’un Bernard-Henri Levy). On peut affirmer de manière très polémique ses désaccords avec le philosophe, penseur et médiatique Finkielkraut tout en respectant l’homme. Il est intervenu il y a dix ans en faveur d’un écrivain qui faisait alors l’objet d’un lynchage médiatique (excessivement disproportionné eu égard ce qui lui était reproché). Et Finkielkraut était bien le seul parmi ceux que l’on pourrait appeler des “intellectuels de renom”. C’était faire preuve d’un certain courage, du moins pour un “intellectuel médiatique”. D’ailleurs ce “soutien” a mis fin à la collaboration (même ponctuelle) de Finkielkraut avec Le Monde. Certes notre philosophe s’exprime depuis dans les colonnes du Figaro, mais j’imagine que pour l’intéressé ce n’est pas exactement la même chose.], Michéa et consort, se plaignent depuis de longues années de la complaisance, voire de la fascination d’une partie des intellectuels ou artistes envers les délinquants (des plaintes qui trouveront la réponse politique la plus adaptée dans le discours de Sarkozy à Bercy du 29 avril 2007), ne citent jamais le magistral ouvrage de Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses. On les comprend ! Chevalier y relève en quelque sorte la naissance du “sentiment d’insécurité” avec la parution en 1825 du premier numéro de La gazette des tribunaux : “Du jour au lendemain les Parisiens, trouvant rassemblés dans ces pages une masse de faits qu’ils apprenaient jusqu’alors en ordre dispersé, eurent l’impression — disons la certitude — que la capitale était encore moins sûre qu’ils ne le pensaient et que de véritables bandes de voleurs, nombreuses et organisées, menaçaient leur sécurité”. L’instrumentalisation proprement dite de ce “sentiment d’insécurité” par le pouvoir politique viendra beaucoup plus tard. Il faudra attendre le début du XXIe siècle (avec le premier gouvernement Raffarin de la seconde présidence Chirac, et la diligence du ministre de l’Intérieur Sarkozy) pour s’en servir comme d’un “mode de gouvernement”. En cela il avait été précédé et préparé par la surenchère électoraliste entre Chirac et Jospin sur ce “sentiment d’insécurité” : le premier, alors en perte de vitesse, jouant une toute autre carte que celle, usée jusqu’à la corde (la fracture sociale) de 1995 ; et le second poursuivant logiquement le chemin balisé depuis le colloque de Villepinte de 1997 (date de l’aggiornamento du P.S. sur les “questions de sécurité”). À ce jeu la droite, mieux préparée, plus crédible et plus décomplexée ne pouvait que l’emporter. Tout ceci est bien connu. On sait aussi que ces discours sécuritaires trouvaient une explication, ou se justifiaient par la présence, sur le plan électoral, d’une forte extrême-droite. Fabius, auparavant, avait ouvert la boite à Pandore en déclarant que le FN apportait de mauvaises réponses à de bonnes questions. C’était faux bien entendu : les questions s’avéraient déjà fallacieuses. En revanche, pas ou peu de commentateurs ont relevé que la mise sur orbite de ce discours sécuritaire avait été effectuée dans les lendemains du mouvement social de 1995. Cela n’est pourtant pas anodin.
La délinquance dite juvénile ne date certes pas d’hier. Mais durant les années 60 elle va pour la première fois connaître une forte exposition médiatique à travers l’apparition de bandes d’adolescents appelés “blousons noirs”. Un phénomène qu’il convient de mettre en relation avec les débuts du rock’n’roll dans l’hexagone et la montée en puissance des adolescents comme nouveau public de consommateurs. Ces blousons noirs appartiennent majoritairement à la classe ouvrière. La société dite d’abondance créait de nouveaux besoins qui ne pouvait être satisfaits que de manière partielle par la jeunesse des milieux populaires. D’où l’importance à l’époque des délits tels que le vol de cyclomoteurs ou de voitures. La présence de ces bandes est elle liée à la politique urbanistique du début du gaullisme, celle des grands ensembles. Un film mineur de Marcel Carné, Terrain vague, l’illustre bien sur le plan sociologique.
C’est là qu’il faut faire retour sur Classes laborieuses et classes dangereuses. Comme introduction à son livre III, “Le crime, expression d’un état pathologique considéré dans ses effets”, Louis Chevalier, partant de l’accroissement et du remaniement démographique de la population parisienne durant la première moitié du XIXe siècle, observe que la population ouvrière (qui bénéficie d’une importante immigration provinciale), déjà reléguée dans un espace géographique, l’est également sur le plan symbolique : “sinon dans la condition criminelle, du moins aux confins de l’économie, de la société et presque de l’existence, dans une condition matérielle, morale et fondamentalement biologique qui est favorable à la criminalité et dont la criminalité est une possible conséquence”. D’où, pour Chevalier, les lignes suivantes, en forme de constat : “En marge de la ville et pour ainsi dire aux frontières de la condition criminelle, cette population l’est dans les faits ; mais elle l’est aussi, d’autre part, dans l’opinion concernant ces faits et qui est elle-même un fait. Telles sont les raisons pour lesquelles cette population adopte à tous égards, dans son genre de vie, dans son attitude politique ou religieuse, dans son existence privée ou publique, un comportement qui correspond à l’opinion qu’on en a, à ce qu’on veut qu’il soit, à ce qu’elle accepte elle-même qu’il soit, volontairement ou passivement, par la force de cette opinion collective, par la soumission à cette universelle condamnation”.
Il fallait citer entièrement ce magistral et très éclairant passage qui n’est pas sans renvoyer, comme nous le verrons plus tard, à notre “bel aujourd’hui”. Louis Chevalier relève ensuite dans ce livre III, parmi les nombreux exemples proposés, ceux des “mauvaises mœurs ouvrières” (en particulier le concubinage dont les pratiquants savent qu’il “est un état contraire aux règles de la morale et aux coutumes de la société, mais qui en raison de la généralisation de cette pratique autour d’eux, qu’ils relèvent à dessein, les absous du “reproche d’immoralité””), l’ivrognerie et de nouveaux modes de mendicité. On jette plus volontiers l’ostracisme sur les nouveaux venus à Paris (l’immigration est constante dans la première moitié du XIXe siècle) que sur la population parisienne “de souche”. Ce sont les premiers que l’on désigne plus communément sous les vocables “barbares”, “misérables”, “sauvages” et même “nomades”. Le baron Haussmann déclare que Paris appartient à la France et pas aux Parisiens de naissance et encore moins aux Parisiens d’adoption, cette “tourbe de nomades”. Le mot “populace” rencontre un certain succès lorsqu’il s’agit de confondre les groupes populaires et criminels. Chevalier, commentant l’absence de frontière entre ces groupes, donc rassemblant plus que séparant, précise que ces groupes sociaux “dont l’affectation est incertaine” appartiennent “aux classes laborieuses assurément, mais d’un labeur abject ou considéré comme tel, et auxquels la plupart des descriptions criminelles de ce temps n’hésitent pas à emprunter le plus communément leurs exemples”.
Les analyses de Louis Chevalier, je l’ai déjà souligné, prennent d’autant plus de résonance qu’elles retrouvent aujourd’hui, depuis une vingtaine d’années disons, un regain d’actualité. À la différence près que ces “classes dangereuses”, qui désignaient à Paris dans la première moitié du XIXe siècle une classe ouvrière revue et corrigée pour les besoins de la cause que l’on sait, renvoient de nos jours à la jeunesse vivant dans les banlieues populaires des grandes villes (avec une focalisation sur la région parisienne qui n’a pas été démentie par les émeutes de l’automne 2005). Sur ces “nouvelles classes dangereuses” on trouvera maints commentaires des Haussmann, Thiers, Fragier, Duchatel et Richerand de notre époque, reprenant des épithètes empruntées à la bourgeoisie du premier XIXe siècle (qui avaient pourtant disparu du langage des dominants depuis 1848 !), les stigmatisant : certains parlant de “barbares”, d’autres de “sauvageons”, ou encore de “racailles” (en reconnaissant que ce dernier mot doit davantage sa fortune à Sarkozy qu’à l’un des personnages cités : au XIXe siècle on utilisait son synonyme “canaille”). En référence à ces bandes violentes dont les médias et les politiques amplifient la dangerosité, Chevalier consacre plusieurs pages aux violences compagnonniques qui opposaient dans la première moitié du XIXe siècle des sociétés rivales. Une violence réelle certes, mais déjà une violence montée en épingle par la presse de l’époque et stigmatisée par les “honnêtes gens”.
Un lien également peut être fait entre la violence juvénile et ce phénomène de bandes dans l’ouvrage savoureux de Bertrand Rothé, Lebrac, trois ans de prison. Ce livre reprend l’action et les personnages du roman La guerre des boutons (de l’excellent Louis Pergaud) pour les transposer dans la France d’aujourd’hui. D’où il en découle un enchaînement de faits (dépôt de plainte, examen aux urgences médico-judiciaires, interpellation policière au Lycée, garde à vue, audition filmée, menace d’une inculpation pour “violence avec arme par destination”, nuit passée au dépôt du Palais de Justice, rencontre avec l’éducateur du tribunal, convocation avec les parents dans le bureau du juge pour enfants, inculpation pour “violence ayant entraîné une ITT de plus de huit jours avec armes”, placement en liberté surveillée, suivi éducatif, etc., etc.) à côté duquel le moindre parcours de combattant relève de la plaisanterie. On me répondra que la France de 2009 n’est plus celle de 1912. Certains des intervenants de la chaîne en question objecteront qu’ils sont là — en s’en excusant ou en le justifiant, selon les points de vue — pour répondre à la demande de la société. Sans doute, mais de quelle nature est cette demande, et pour quelle société ? La réponse nous intéresse, forcément.
Si aujourd’hui comme hier on ne saurait nier l’existence d’un potentiel de violence chez les uns, les ouvriers du XIXe siècle, et les autres, la jeunesse populaire des banlieues, en revanche, pour reprendre un mot qui fait florès, l’insécurité (du moins telle qu’elle est présentée et problématisée dans le débat public) renvoie à un mythe (pour parler comme Pierre Tevanian) ou à une construction idéologique. Nous entrons dans le registre de la manipulation. Celle des chiffres, qui reflètent plus la réalité de l’activité policière que celle de la délinquance. En demandant bien entendu aux policiers de faire du chiffre, davantage de chiffre pour gonfler les statistiques. La forte présence, parmi les infractions relevées, d’outrages à agent vérifie plus l’augmentation sensible des contrôles policiers (sans parler d’un seuil de tolérance policier devenu ridiculement bas en Sarkozie) que la montée des incivilités. On remarque également que la violence patronale (observable à travers de multiples infractions au code du travail) suscite moins l’intérêt de la justice que lorsque cette violence émane des milieux défavorisés. Comme le relève Pierre Tevanian les mots “violence” et “délinquance” ne sont pas interchangeables et désignent des réalités différentes. L’amalgame “permet d’imposer sans le dire une thèse implicite” : celle selon laquelle le “premier mot de travers” ou la “première incivilité” mènent inéluctablement, selon une progression continue, à la délinquance, voire la criminalité. Cela vaut aussi pour des “problèmes de société” du type de ces “tournantes” très médiatisées au tout début de ce siècle. Une focalisation qui a depuis fait long feu : cette “mise en scène médiatique”, initiée pour ne pas dire instrumentalisée par l’association Ni pute ni soumise, s’étant progressivement dégonflée devant l’examen des faits et les verdicts des cours d’assise.
Jean-Claude Michéa serait socialiste. Le socialisme dans lequel se reconnaîtrait notre philosophe remonte aux premiers temps de la doctrine, ceux d’un “socialisme originel” dont le principe selon Michéa exclut tout clivage gauche / droite. Ce socialisme originel étant pour l’auteur la “traduction en idées philosophiques des premières protestations populaires (luddistes et chartistes anglais, canuts de Lyon, tisserands de Silésie, etc.) contre les effets humains et écologiques désastreux de l’industrialisation libérale”. Cette thèse et ce positionnement ne sont pas très éloignés de ceux défendus par la courant anti-industriel. Michéa n’entend pas associer “socialisme” et “gauche” car ce dernier terme désigne pour lui les “partisans du “progrès” pour qui la révolution industrielle et scientifique (…) conduira par sa seule logique, à réconcilier l’humanité avec elle-même”. Seule, poursuit Michéa, l’affaire Dreyfus inscrira massivement le mouvement socialiste dans le camp de la gauche, donc celles des “forces du Progrès”. Et pourquoi ? Michéa évoque dans un autre ouvrage un compromis historique passé entre la gauche et le mouvement socialiste lors de cette même affaire Dreyfus. Soit, mais quelle est la nature de ce compromis ? Et à quelles fins ? Le lecteur n’en saura rien. On ne sait pas plus, en l’absence de toute autre référence, si cette analyse pour le moins étrange sort du cerveau de Michéa ou si elle lui a été suggérée par untel.
Essayons de comprendre. Aujourd’hui chacun s’accorde à reconnaître que l’affaire Dreyfus signe l’avènement de l’intellectuel (l’adjectif existait mais il devient un nom, à connotation évidemment péjorative, chez les adversaires du capitaine Dreyfus pour désigner les partisans de ce dernier !). Est-ce là, sans vouloir le dire, ni l’expliciter, ce à quoi veut se référer Michéa ? Je constate qu’un autre contempteur des “élites intellectuelles”, Louis Janover, évoque l’affaire Dreyfus (qu’il qualifie de “purge républicaine”) en des termes qui peuvent se rapprocher de ceux de Jean-Claude Michéa. Pour Janover l’affaire Dreyfus “clôt en quelque sorte l’ère de la Sociale et lève le rideau sur la scène de la politique”. Je rappelle que pour une partie du mouvement ouvrier l’affaire Dreyfus résultait d’une lutte entre deux factions rivales de la classe bourgeoise détournant les socialistes (et le peuple) des vrais combats contre le système capitaliste. C’était déjà regrettable, mais cela l’est encore plus lorsqu’on retrouve pareille analyse chez l’un ou l’autre de nos penseurs contemporains. Car ici en l’occurrence rien n’exclut rien : on peut à la fois combattre mordicus le capitalisme et s’insurger contre l’injustice (et c’était plus qu’une injustice !) faite à Dreyfus. Il paraît très possible que Michéa (lecteur de Janover) souscrire à une telle interprétation ou lecture de l’histoire. Rien de ce qu’il écrit par ailleurs ne le démentirait. Mais en l’absence de tout développement michéen sur l’affaire Dreyfus j’en resterai là.
En revanche, notre philosophe est particulièrement disert sur le libéralisme puisque cette thématique prend pour lui le pas sur ses autres sujets de prédilection dans ses deux derniers ouvrages. Sa thèse peut être résumée ainsi : contrairement à la gauche et l’extrême gauche, qui elles distinguent fondamentalement un libéralisme économique et un libéralisme culturel (ce dernier défini par l’auteur comme “l’avancée illimitée des droits et la libération permanente des moeurs”), l’un et l’autre doivent être philosophiquement unifiés. Ne pas le reconnaître, insiste Michéa, revient à faire le jeu d’une pensée unique “dédoublée” qui croise en permanence un discours économiquement correct (le libéralisme économique) et un discours politiquement correct (le libéralisme culturel). D’où les analyses de l’auteur pour inscrire depuis le XVIIIe siècle la philosophie libérale dans un “tableau à double entrée” : soit deux versions parallèles et complémentaires du libéralisme.
Parler de “libéralisme culturel” ne pouvait qu’entraîner Michéa à se pencher sur la modernité qu’il définit curieusement dans L’empire du moindre mal comme une “étrange civilisation qui, la première dans l’Histoire, a entreprit de fonder ses progrès sur la défiance méthodique, la peur de la mort et la conviction qu’aimer et donner étaient des actes impossibles” (sic). Une telle définition renseigne plus sur la subjectivité de notre philosophe, et surtout sur l’une de ses obsessions qu’elle ne nous éclaire sur la chose en question. On finit par comprendre que la modernité (laquelle induit pour Michéa “une image profondément négative de l’homme”) représente l’exact contraire de la common decency. Nous voilà bien avancé ! Certes, Michéa subodorant la faiblesse des analyses de L’empire du moindre mal (des contradicteurs l’ont sans doute aidés en ce sens) y consacre un chapitre supplémentaire dans La double pensée. Ici l’analyse devient étayée par des exemples précis, mieux venus, empruntés à des “modernités secondaires” apparues dans le courant de l’histoire. Pourtant, lorsque Michéa reprend le fil de la réflexion ébauchée dans L’empire du moindre mal, à savoir “le projet occidental moderne forgé dans le contexte de guerre de religion”, notre philosophe se trouve de nouveau emporté par sa verve polémique en décrivant les “différents totalitarismes du XXe siècle” comme des “formes de modernité non libérales”. Cette modernité consubstantiellement liée chez Michéa au “libéralisme culturel” s’en séparerait ici par l’on ne sait quelle opération du Saint-Esprit (à croire qu’il souffle sur notre auteur) pour engendrer les deux totalitarismes du XXe siècle !
Michéa paraît plus convaincant dans son analyse du libéralisme lorsqu’il évoque la tendance, dans nos sociétés contemporaines, du processus de judiciarisation (en provenance des États-Unis) qui tend à opposer des groupes à d’autres groupes ou des personnes à d’autres personnes. Michéa le traduit par la formule un tantinet excessive “une nouvelle guerre de tous contre tous”, non sans préciser que l’extension infinie des droits individuels, laquelle rencontre nécessairement des résistances, y conduit. Trop de liberté, en quelque sorte, mène au prétoire. Le dernier Michéa, féru de psychanalyse, ajoute à cette “guerre de tous contre tous” celle de “chacun contre lui-même”. Donc le libéralisme, non content de faire de nous des procéduriers nous transforme en schizophrènes. Que faire docteur ? Michéa ne le dit pas. Nous aurons certainement la réponse dans l’un de ses prochains ouvrages. Cette “guerre de tous contre tous”, pour y revenir, s’exprime concrètement pour notre philosophe à travers par exemple “les effets anthropologiques quotidiens induits par la transformation capitaliste de l’être humain en automobiliste”. Soit, mais alors que faire de ceux qui, comme l’auteur de ces lignes, n’auraient ni automobile ni même le permis de conduire ? En quoi ceci les concernerait (anthropologiquement parlant) ? Michéa emporte davantage la conviction quand il aborde la question sous l’angle du tabac, puisque les non fumeurs se trouvent ici davantage concernés.
Le libéralisme culturel et la modernité sont par conséquent tenus responsables pour Michéa de “l’abandon définitif de la question sociale”. Nous lui laissons la responsabilité d’un pareil constat. À vrai dire, comme on le découvrira dans la seconde partie, l’analyse michéenne du libéralisme nous conduit via le “capitalisme moderne” à mai 68.
Dernière thématique à être ici abordée, celle dont il est question dans les paragraphes suivants n’a rien de véritablement original chez Michéa et ne sera donc pas prioritairement traitée depuis les ouvrages de notre philosophe. Je m’y référerai cependant pour apporter ici ou là quelque précision utile ou relancer si besoin est la discussion.
Il paraît de bon ton dans des sphères ou des milieux qui, par le passé — un passé relativement récent — usaient, voire abusaient des références révolutionnaire ou radicale (dans la mesure ou l’une n’excluait pas l’autre) de trouver des individus se disant aujourd’hui “conservateur”, et même (par goût inversé de l’extrémisme) “réactionnaire”. Même si les personnes décrites ci-dessus ne revendiquaient nullement une appartenance au camp des gauches (ou tenaient à s’en distinguer), elles se gardaient bien de reprendre en ce qui les concernaient de telles épithètes pour le moins péjoratives en ce temps-là encore à leurs yeux. Il y aurait donc comme un changement de paradigme qui, de par ces inversions, transforme le plomb et or, et réciproquement. Sachant que c’est plus particulièrement le “progressisme” qui se trouve ici voué aux gémonies tandis que les références au conservatisme et à la réaction cessent d’être négatives. On remarque, non sans ironie, que parmi ces plaignants nombreux sont ceux qui usent de l’adjectif “progressif” en reprenant à l’intonation près le mode d’accusation jadis réservé au type “réactionnaire”. Dans cette histoire Michéa joue le rôle d’un vulgarisateur. D’autres l’ont précédé, nous verrons plus loin lesquels. Dans L’enseignement de l’ignorance les terminologies “conservateur” et “réactionnaire” sont décrites comme “les deux figures par excellence de l’incorrection politique”. L’astuce michéenne consistant à l’expliquer par l’impositon du Spectacle. Dans ses autres ouvrages Michéa revient sur ce qu’il appelle “la croyance au caractère conservateur de l’ordre économique et libéral” des militants de gauche et d’extrême-gauche.
Mettons de côté Philippe Muray, qui n’est pas à proprement parler l’un des inspirateurs de Jean-Claude Michéa. En revanche Christopher Lasch, qui doit son actuel crédit aux efforts déployés par Michéa et les éditions Climats pour faire connaître son œuvre en France, en fait incontestablement partie. D’aucuns estimant même que tout Michéa vient de Lasch pourraient me reprocher de consacrer trop de place à la copie alors que l’original se trouve mis aujourd’hui à la disposition du lecteur de langue française. Je répondrai d’abord que Michéa doit certes beaucoup à Lasch mais qu’il a su adapter la pensée du philosophe américain à la spécificité hexagonale. Et puis la copie finit parfois par l’emporter sur l’original. L’exemple durant la dernière campagne présidentielle de Sarkozy et le Pen apporte la preuve que les électeurs peuvent légitimement préférer la première à la seconde.
Parmi les autres références il en est une, moins revendiquée, qui peut le cas échéant prendre la forme d’un compagnonnage (du moins chez Michéa) : je veux parler de la proximité de notre philosophe avec le courant anti-industriel. J’ai consacré un petit essai (Du temps que les situationnistes avaient raison) à la principale composante de ce courant et, comme je l’ai déjà dit plus haut, j’y renvoie le lecteur. Ici Michéa cite volontiers dans ses ouvrages Jaime Semprun, René Riesel et Jean-Marc Mandosio sans pour autant faire sien l’impératif catégorique : “Il n’y a plus rien à faire, et de toute façon c’est déjà trop tard”. C’est dire que sa montre ne s’est pas arrêtée au XIXe siècle lors de l’avènement de la révolution industrielle : accréditant, par cela même, l’idée que tous les malheurs de l’humanité proviennent de cette industrialisation. C’est aussi dire que Michéa ne souscrit pas non plus à quelque “fin de l’histoire” jamais dite en tant que telle, et encore moins revendiquée, mais qui reste indéfectiblement liée à l’impératif catégorique énoncé plus haut. Cette “proximité” s’explique davantage par des aversions ou ennemis communs au sein desquels le “progressisme” figure à la première place.
La notion de “progrès” on le sait n’a pas bonne presse de nos jours pour de bonnes et mauvaises raisons. Les premières sont bien connues depuis la fin des années 60, date d’une première prise de conscience écologique, laquelle, parallèlement, entraînait la critique, ou la mise en accusation des sciences, techniques et technologies. Pour prendre un exemple critique que cite Jean-Claude Michéa dans L’enseignement de l’ignorance (avec lequel je tiens pour une fois à manifester mon accord), l’ouvrage d’Alain Roger Court traité du paysage avait également attiré mon attention lors de sa parution en 1997. Cet esthéticien insiste dans son livre sur la distinction entre paysage et environnement. Il importe à cet auteur de démontrer que le paysage “est toujours une invention historique et essentiellement esthétique” qui ressort d’un phénomène “d’artialisation” : ce dernier désignant des opérations in situ (l’œuvre des jardiniers, des paysagistes, du Land Art) ou in visu (celles des peintres, des écrivains, des photographes). Par conséquent, pour Roger, “il ne saurait y avoir une science du paysage”. Ce qui n’est pas pour lui le cas de l’environnement, “concept récent, d’origine écologique, et justifiable, à ce titre, d’un traitement scientifique”. La distinction paraît fondée : il semble préférable, pour bien s’entendre, de ne pas confondre l’un avec l’autre. À l’appui de cette thèse, “le paysage s’invente, n’est pas une notion figée”, Alain Roger cite a contrario un exemple caricatural, celui de la Charte architecturale et paysagère de la région Auvergne. Cette charte recommande la plantation “d’essences locales et non exotiques” et celles “de feuillages caducs et non persistants”. Une recommandation qui rappelle à Roger de fâcheux souvenirs, ceux laissés par les paysagistes du Troisième Reich qui réclamaient une “guerre d’extermination” contre les essences étrangères menaçant la pureté du paysage allemand. Pour aller dans le sens de la thèse d’Alain Roger, les pins, qui donnent aujourd’hui ce cachet particulier à la forêt de Fontainebleau, ont été plantés à la fin du XVIIIe siècle. Nous avons là une illustration du paysage comme “invention historique”. J’ajoute qu’Adolphe Alphant, le maître d’œuvre des parcs parisiens du Second empire, faisait l’éloge des plantes exotiques et prescrivait de les “entretenir avec tous les soins que réclame cette aristocratie végétale”.
Alain Roger dérape, en quelque sorte, lorsque son Court traité du paysage abandonne la réflexion historique et esthétique pour manifester son aversion à l’égard de l’écologie. Ou comment, partant d’une analyse fine et pertinente (sur l’histoire du paysage), il en vient à prendre le contre-pied des discours écologiques pour dénoncer le “conservatisme” de leurs discours de préservation, de protection et de sauvegarde du paysage. Il faut vivre avec son temps, insiste Roger, et ne pas se “recroqueviller sur le passé”. Et ne pas figer la “pratique paysagère” en musée afin “d’inventer l’avenir” et “de nourrir le regard de demain”. La présence d’Alain Roger au sein du “Comité d’experts Environnement et paysage” mis en place par la direction des routes au ministère de l’Équipement, explique en partie les positions de notre esthéticien. Curieusement, à aucun moment, Roger ne se réfère à la loi du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites dont la conservation et la préservation présentent un intérêt général du point de vue “artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque”. Cette loi permet d’inscrire les sites qui mériteraient d’être protégés, puis de les classer. Une procédure qui, on le sait, a permis de sauvegarder des sites menacés par des intérêts privés. Jusqu’à un certain point, certes, si l’on met par exemple des deux côtés de la balance, d’une part le projet Eurodisney, et de l’autre le classement du site de la crête de Chalifert (situé à proximité, et célébré par des peintres paysagistes du XIXe siècle) : soit la lutte du pot de fer et du pot de terre. Un exemple parmi d’autres d’une situation où l’État bafoue la légalité qu’il est censé défendre.
Le paysage est une invention, soit. Mais il importe alors de distinguer paysage et paysage. Car tous les paysages ne sont pas soumis au même phénomène d’artialisation. Pour certains cela ne prête guère à conséquence : on reste dans le domaine du commun, de l’ordinaire et du convenu. D’autres par contre se cristallisent en quelque sorte à travers le regard que des artistes, des écrivains, ou tout simplement les passants portent sur eux. Cette élaboration, cette reconstruction sont celles d’un imaginaire. À moins d’être une brute ou un butor on ne peut pas vivre sans imaginaire. La destruction d’un site s’avère par conséquent préjudiciable à tous (en exceptant ceux qui bien entendu en tirent un profit pécuniaire ou autre). On comprend mieux maintenant l’oubli chez Alain Roger du mot “site”. Puisque ce dernier renvoie à la fois au paysage et à l’environnement (ici en raison du caractère particulier que lui confère la loi du 2 mai 1930). La distinction qu’il convenait de souligner, du point de vue sémantique, et pour toutes les bonnes raisons évoquées plus haut, vole en éclat dès lors que nous l’abordons sous l’angle d’un site. Comment ne pas évoquer quelque duplicité, ou une volonté de noyer le poisson quand des propos, à l’origine pertinents sur les plans historiques et esthétiques, finissent par servir des intérêts privés ou prétendument publics. Doit-on rappeler que le moindre de ces projets devrait faire l’objet, au préalable (y compris par l’imposition, et cela sans lésiner sur les modes d’actions, mêmes violentes), d’un débat et d’une consultation avec tous les intéressés. Mais on aura compris que des arguments et des démonstrations du type Alain Roger justifient par avance l’affairisme et ses complicités.
Ce n’est pas par hasard que je me suis livré à ce long commentaire sur Court traité du paysage car il contient les prémices de l’un des aspects de la question qui nous occupe ici. Dans Du temps que les situationnistes avaient raison, au sujet d’un échange polémique entre Jaime Semprun et Norbert Trenkle (l’un des animateurs de la revue Kristis ), je constatais : “On voit parfaitement ce qui sépare Semprun et Trenkle. Là où le premier, pour expliquer le monde tel qu’il ne va pas, se focalise sur la production industrielle et les nouvelles technologies, le second, partant des contradictions entre forces productives et rapports de production, tente de définir le cadre qui permettrait de mettre la science et les technologies à l’épreuve des choix par lesquels nous aspirons à vivre dans une société plus libre, plus juste, plus solidaire, plus riche en potentialités diverses. C’est aussi la question de la démocratie qui est posée ici. Il faudra bien y revenir”.
Nous y revenons. Non sans avoir précisé préalablement que les sciences et techniques ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Une confiance absolue (la position technophile) est aussi condamnable que l’affirmation d’un refus tout aussi absolu (la position technophobe). La critique bien entendu prévaut dans ce monde célébrant l’horizon indépassable des nouvelles technologies. Celles-ci, il va de soi, génèrent des formes inédites de dépendance et d’aliénation. Mais après tout la comparaison s’impose, en terme de nocivité, avec l’aliénation religieuse du monde préindustriel (décrit par d’aucuns comme “un âge d’or”). Les théoriciens anti-industriels, les auteurs des éditions de “L’encyclopédie des Nuisances”, et le premier cercle de leurs lecteurs savent pertinemment — mieux que quiconque même ! — que l’on ne reviendra jamais en arrière, c’est-à-dire aux temps préindustriels. Ils ne défendent pas une utopie dans le sens par exemple de Fourier et des utopistes les plus conséquents : à savoir la figure d’un monde comme objet de désir, à la fois inaccessible et relevant d’une nécessité, désirable car inaccessible, réalisable de part cette nécessité.
Donc, dans la société que j’appelle, que nous appelons de nos vœux, l’usage des sciences, techniques et technologies devient l’un des éléments d’une discussion plus globale sur ce qui serait utile ou pas pour l’humanité. Il ne s’agit pas ici de trancher en ce sens, ou de décliner des préférences, mais de définir le cadre dans lequel cette discussion pourrait ou devrait avoir lieu. Parler par conséquent de démocratie suppose que les thèmes relevant de cette discussion soient débattus par tous dans la vie de tous les jours, et d’une manière que l’on aimerait décisive dans un contexte d’affrontement, au travers d’un mouvement social, et pour le mieux au sein d’assemblées prenant la forme de conseils dans les entreprises, les quartiers et les institutions de toutes sortes. Il ne s’agit donc pas, on l’a compris, de “débats citoyens” organisés par le pouvoir en place ou un collège d’experts. Cette discussion doit cependant avoir lieu préalablement, et dans les formes requises pour générer les conflits de demain. J’ajoute que la question de la démocratie (que je ne fait qu’aborder), de la manière dont elle se trouve énoncée ici, est très naturellement et très logiquement absente des ouvrages des auteurs du courant anti-industriel, puisque en aucun cas ce monde ne peut être pour eux transformé. Tout comme elle n’apparaît pas dans les livres de Michéa. Là les raisons sont plus complexes, mais on peut avancer que les développements michéens sur la common decency lui permettent de faire l’impasse sur la question, ou “de botter en touche” (pour reprendre une métaphore sportive).
L’infortune que rencontre depuis une trentaine d’années la notion de progrès prend toute sa dimension si on la compare à la fortune du mot, de la notion, du concept durant le XIXe siècle et la plus grande partie du XXe. Parler de progrès allait alors de soi (du moins dans le camp de la gauche) : “progrès scientifique” et “progrès social” marchant d’un même pas. Parmi plusieurs définitions le Robert évoque un “développement en bien”. Puis vint le temps de la suspicion : principalement en raison de la prise de conscience écologique évoquée plus haut. Pour le coup la notion de progrès scientifique, ce développement du bien, s’en trouvait ébranlée. Et avec elle le crédit jusqu’alors accordé aux technologies censées contribuer à l’amélioration du genre humain. La science, ou un certain usage de la science faisait l’objet d’accusations, y compris par des membres de la communauté scientifique. Cependant, par une ruse de l’histoire, la critique légitime de ce progrès-là, celle des sciences, techniques et technologies, s’est élargie à la notion de progrès en général. Il y a sous cet angle comme une collusion entre des courants de pensée qui n’ont pas ou peu de choses en commun, sinon dans la dénonciation réitérée du Progrès devenu une sorte de Grand Satan à l’échelle occidentale. C’est là qu’il faut distinguer, et bien distinguer.
Les écrivains, les premiers, ont fustigé le progrès. Baudelaire dans un célèbre fragment de Fusées lui reproche d’atrophier “en nous toute la partie spirituelle”. Flaubert crée avec l’apothicaire Homais un type universel : le parangon de ceux qui au nom de la science et du progrès dessinent les contours d’une sinistre société hygiéniste. Plus tard Benjamin, dans Sur le concept d’histoire, le métaphorise à travers l’analyse d’un tableau de Klee. Sur un plan plus philosophique, sans vouloir remonter à Nietzsche, juste après la Seconde guerre mondiale Adorno insistera dans Minima moralia sur le “caractère double du progrès” en précisant qu’il avait “toujours développé le potentiel de liberté en même temps que la réalité de l’oppression”. C’est ce que chacun devait avoir en tête dans la moindre discussion sur la notion de progrès. Celui-ci n’est pas uniquement associé aux sciences, techniques et technologies, mais englobe tous les aspects de l’activité humaine. Il faut progresser vers plus de liberté, d’égalité, de solidarité, de richesse intérieure, pour s’affranchir des pouvoirs, des idéologies, de la raison raisonnante. Il conviendrait en amont de se prémunir contre les “amis” et les “ennemis” du progrès. Et donc de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Ni même, pour finir sur Jean-Claude Michéa, des lanternes pour des vessies.
Max Vincent, L’obstination de toute une vie, Réflexions partielles et apparemment partiales sur l’époque et le monde tel qu’il va, janvier 2010