Bruits de bottes à Ouagadougou

Questions à… Romain Tiquet, doctorant en histoire de l’Afrique à la Humbolt Universität de Berlin. Ses premiers travaux, effectués à la Sorbonne, portaient sur l’histoire de la police au Burkina Faso. Avec le GEMPA (groupe d’études sur les mondes policiers en Afrique), il a notamment publié le portrait biographique d’Hubert Kho, qui fut le premier Africain à être devenu officier de police à la fin de l’âge colonial (Maintenir l’ordre colonial, Afrique et Madagascar, Rennes, PUR, 2012).
Le général Honoré Traoré et le colonel Zida se sont disputés le pouvoir au lendemain de la chute de Blaise Compaoré : quel est le paysage des forces armées au Burkina ?
La confusion qui a régné au lendemain de la chute du régime de « Blaise » est à l’image des dissensions qui existent au sein de l’armée burkinabè depuis la fin des années 2000. L’armée jouissait sous l’ère Compaoré d’un relatif prestige et respect, tant au sein de la population qu’au niveau international. Cependant, un tournant notable s’effectua avec les mutineries de 2011. À la suite de diverses affaires de mœurs, plusieurs casernes de soldats se soulevèrent contre leur hiérarchie jugée corrompue. La base de l’armée montrait par la même son hostilité au pouvoir en place alors même que le président Compaoré tentait de contrôler par tous les moyens cette institution dont il était lui même issu. Cette mutinerie s’inscrivait plus largement dans un contexte de révoltes sociales révélant une ligne de fracture profonde entre populations et élites politiques dans le pays. Ces évènements ont en quelque sorte démystifié la toute puissance de la « grande muette » et ont par la même échaudé le pouvoir en place, dans un pays où la stabilité politique était étroitement liée à la stabilité de l’armée. Concernant la situation actuelle, Il faut être attentif à ce que va faire Isaac Zida dans les prochains jours. Bien qu’adoubé par l’armée et soutenu par une partie de la population, il reste pour beaucoup le numéro deux de l’ancien Régiment de Sécurité Présidentielle (RSP) et le protégé du très discret Gilbert Diendéré. Cette armée dans l’armée, véritable cordon de sécurité de Compaoré, est composée des plus fidèles du président et jouit de moyens logistiques et de surveillance très important.
Que fait la police ? Principale force de l’ordre et première représentante des « corps habillés », elle semble absente (ou silencieuse) dans cette crise.
La police n’a pas été véritablement absente puisqu’elle est intervenue dans les opérations de maintien de l’ordre pendant les évènements des 30 et 31 octobre 2014. Ce sont les compagnies de CRS qui repoussèrent, à coups de gaz lacrymogènes, les manifestants réunis devant l’assemblée nationale le jeudi 30 octobre, date à laquelle les députés devaient voter la révision constitutionnelle contestée. L’absence de répression violente de la part des forces de police, au même titre que l’armée, vaut à mon sens valeur de soutien au soulèvement populaire qui renversa Blaise Compaoré le 31 octobre 2014. On aurait pu en effet assister au même scénario de répression qu’en Côte d’Ivoire durant la crise postélectorale de 2011. Il faut par ailleurs garder en tête que les forces civiles de police ont toujours été marginalisées dans un pays où culture politique et culture militaire sont intiment liées. Ainsi, il n’était pas rare de voir des commandants de l’armée ou de la Gendarmerie prendre la tête de la direction de la police nationale au Burkina. Mal payées et mal équipées, les forces de police souffrent d’un discrédit du coté des populations, qui les jugent corrompues et peu fiables, et du coté du pouvoir politique qui les considèrent comme moins efficaces et moins disciplinées que l’armée ou la gendarmerie.
Quelle place occupe l’armée dans le processus politique au Burkina depuis son indépendance ?
La place de l’armée est centrale au Burkina. Il faut garder en tête que seul le régime du premier président Maurice Yaméogo (1960-1966) était un régime civil. De 1966 à 1987, la vie politique burkinabè fut ponctuée de coups d’État militaires. De 1966 à 1980, Sangoulé Lamizana prit les rênes du pouvoir, alternant régime militaire et civil. S’en suivent alors trois putschs en à peine trois ans. En 1980, le colonel Saye Zerbo renverse Lamizana. Zerbo est lui même détrôné par Jean-Baptiste Ouédraogo en 1982. À peine un an plus tard, le 4 août 1983, c’est au tour de Thomas Sankara de s’installer au pouvoir d’un régime militaire socialisant, dont le numéro deux n’était autre que Blaise Compaoré. Ces coups d’État militaire révèlent un véritable conflit de génération au sein de l’armée de l’époque. On a la vieille garde incarnée par Lamizana, formée par les guerres coloniales d’Indochine et d’Algérie. Une seconde génération intermédiaire, représentée par Zerbo, émerge quant à elle après l’indépendance. Enfin une jeune garde, dont font partie Sankara et Compaoré, composée d’officiers subalternes et influencée par les théories marxistes. Blaise Compaoré renverse Sankara en 1987 et s’entoure de militaires malgré une transition vers un régime civil. Bien que plus silencieuse, l’armée reste un pilier central de l’appareil politique.
Publié par des ennemis de la révolution burkinabè (Propos recueillis par Jean-Pierre Bat, Africa4, 14 novembre 2014)
Thomas Sankara, l’âme de fond de la révolution au Burkina Faso
GRAND ANGLE | Le «Che Guevara africain», assassiné en 1987 et remplacé par Blaise Compaoré [sic -NdJL], est devenu l’une des figures emblématiques du «Balai citoyen». Un mouvement de la jeunesse qui a joué un rôle clé dans le départ du chef de l’État.

Le capitaine Thomas Sankara, président du Burkina Faso (ancien Haute Volta), pose avec Francois Mitterrand à Vittel, le 3 octobre 1983.
C’est une tombe enfin «libérée». Celle d’un mort, dont le seul nom suffit, encore aujourd’hui, à galvaniser les foules africaines et bien plus encore celles de son pays natal, le Burkina Faso. Le soulèvement populaire qui a embrasé pendant la dernière semaine d’octobre ce petit État d’Afrique de l’Ouest, balayant le régime en place, a aussi permis de libérer l’accès au cimetière de Dagnoe, gardé depuis plusieurs décennies par des militaires armés. Lesquels en interdisaient l’entrée sans laissez-passer officiel, à l’exception d’un seul jour dans l’année. Début novembre, ils ont discrètement disparu.
Un leader contre «l’Occident repu»
Ce vaste cimetière aux tombes éparses, isolé à la périphérie de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, abrite celle de Thomas Sankara, le «Che Guevara africain». Un leader singulier, charismatique et visionnaire rendu célèbre par ses projets en faveur de l’autosuffisance nationale et ses discours audacieux. Comme celui à la tribune des Nations unies, en octobre 1984, lorsqu’il n’avait pas hésité, avec une politesse malicieuse, à affirmer aux grands de ce monde que son tout petit pays souhaitait «risquer de nouvelles voies pour être plus heureux» et ne plus être «l’arrière-monde de l’Occident repu». Le rêve était peut-être utopique ou idéaliste, il fut en tout cas vite brisé. Jeune capitaine de l’armée burkinabée, Sankara a pris le pouvoir à 34 ans, en 1984. Moins de quatre ans plus tard, le 15 octobre 1987, il sera renversé et assassiné. Son tombeur n’est autre que son plus proche collaborateur, son frère d’armes, son ami : Blaise Compaoré. Celui-ci devient alors l’homme fort du pays, à sa tête durant vingt-sept ans, avant que les manifestants de Ouagadougou ne le contraignent, le 31 octobre, à une fuite peu glorieuse.
Durant toutes ces années, le président fratricide aura tenté en vain de se débarrasser d’un fantôme qui ressurgit aujourd’hui avec d’autant plus de force que l’insurrection populaire d’octobre s’est réclamée de son nom. «Sankara», souffle Souleymane Ouedraogo devant les portes désormais grandes ouvertes du cimetière. «Pendant toutes ces années, on a maintenu vivante la flamme de son souvenir. Nos parents nous parlaient sans cesse de lui à la maison. Encore petit, j’avais dessiné un portrait de Sankara que mon père, alors installé en Côte-d’Ivoire [pays frontalier, ndlr], avait mis dans sa boutique. Ma première fierté d’enfant ! s’exclame ce jeune quadragénaire avec enthousiasme. Mais jusqu’à début novembre, personne ne pouvait venir se recueillir sur sa tombe. Sauf le 15 octobre, jour qui commémorait son assassinat.» Son regard balaye le cimetière silencieux, où se détache au loin la sépulture de Thomas Sankara, peinte aux couleurs vives du drapeau burkinabé. Elle est entourée d’une douzaine de tombes blanches, celles de ses collaborateurs, tous fauchés par les balles des mutins qui ont surgi ce fameux «jeudi noir» d’octobre 1987, lors d’une banale réunion de travail.
Au Burkina Faso, personne ne s’attendait à ce coup d’État, et personne n’a oublié la stupeur qui a saisi le pays à ce moment-là. Puis le silence s’est imposé, pour longtemps. Jeune rappeur engagé sous le nom de scène de Basic Soul, Souleymane Ouedraogo a composé en 2003 une chanson intitulée Capitaine. Immédiatement interdite de diffusion car elle évoquait Thomas Sankara. D’autres artistes, comme Smockey ou Sams’K Le Jah, s’y sont également risqués, avant de subir eux aussi la censure du régime.
Le pays des hommes rebelles
On les retrouve tous, un matin de novembre, dans une banlieue misérable, à l’autre extrémité de la capitale. Le long d’une route défoncée, parsemée d’ordures au milieu desquelles broutent des chèvres, s’égrène une série de petites boutiques aux façades d’un beige triste. Avec quelques camarades, Souleymane, Smockey et Sam sont venus présenter leurs condoléances à la famille d’une des victimes des journées d’insurrection fin octobre. Abdul Moubarak Belem était un jeune plombier de 18 ans, il n’a jamais connu Sankara. Une balle en pleine tête a mis un terme à sa courte existence lors des manifestations qui ont forcé Compaoré à quitter le pouvoir. Sa famille a retrouvé son corps à la morgue. «On ne peut imaginer à quel point la mort d’un être créé un vide. Nos mots ne suffiront pas», s’excuse presque Sam devant le père d’Abdul, digne vieil homme en gandoura (tunique sans manches), qui écoute en silence, le regard sombre. Avant de prendre la parole à son tour : «Mon fils est un vrai citoyen. Il a donné sa vie pour le Burkina Faso», souligne-t-il avec une fierté tremblante. «La patrie ou la mort» : le fameux slogan de Sankara, refrain de l’hymne national, n’a visiblement rien perdu de son actualité.
Blaise Compaoré aurait dû s’en douter, car c’est une longue histoire : la Haute-Volta, rebaptisée en 1984 «Pays des hommes intègres» (Burkina Faso) par Thomas Sankara, est aussi le pays des hommes rebelles, jamais totalement soumis malgré un tempérament plutôt pacifique. «La génération de nos parents s’était déjà révoltée le 3 janvier 1966, renversant le régime corrompu du premier président, Maurice Yaméogo, rappelle Zinaba Rasmane, 28 ans, étudiant en maîtrise de philosophie. C’était la première insurrection populaire de l’Afrique postcoloniale.» Le jeune homme fut lui-même aux premières loges de la dernière révolution, considérée par certains comme l’aube annonciatrice d’un nouveau printemps africain. «Ma génération n’a connu que Blaise au pouvoir. Mais depuis des années, la colère couve et personne n’a jamais oublié les victimes de son régime», précise encore Zinaba. Il énumère : «Chaque 19 mai depuis 1990, les étudiants refusent d’aller en cours en mémoire de Boukari Dabo, étudiant en médecine assassiné par les sbires de Compaoré. Chaque 6 décembre depuis l’an 2000, ce sont les écoliers qui font grève pour marquer le souvenir du jeune Flavien Nebré, tué par balles lors d’une manifestation. Et chaque 13 décembre, tout le monde se recueille, en mémoire de Norbert Zongo.»
Héros ostracisé
Zinaba est assis devant un «plat de riz-sauce» à la cantine du syndicat des journalistes — un centre de presse, baptisé «Norbert-Zongo» en hommage à ce journaliste assassiné le 13 décembre 1998, presque autant adulé que Thomas Sankara. Son meurtre — vaguement maquillé en accident de voiture — alors qu’il enquêtait sur l’assassinat du chauffeur de François Compaoré, le redoutable frère du Président, avait embrasé le pays, menaçant une première fois de faire tomber le régime. Contraint de lâcher du lest, le tombeur de Sankara accepte alors de modifier la Constitution pour limiter son maintien au pouvoir à deux mandats de cinq ans. C’est cette disposition qu’il a tenté de changer il y a trois semaines pour se représenter en 2015, entraînant sa chute brutale sous la pression de la rue.
C’est aussi en 1998 que Compaoré lève partiellement le tabou qui pesait sur Sankara, subitement élevé officiellement au rang des «héros de la révolution». Mais du bout des lèvres et en tant que héros «parmi d’autres». Des gestes cosmétiques qui n’ont pas réussi à banaliser la figure du leader assassiné : «Pour les jeunes d’aujourd’hui, même ceux qui ne l’ont pas connu, Sankara reste l’homme politique qui les captive le plus. Depuis sa mort, il n’y avait plus d’horizon pour la jeunesse de ce pays», explique Zinaba.
2012, le «déclic» de l’insurrection
Comme Smockey, Sams’K Le Jah ou encore Souleymane, alias Basic Soul, le jeune étudiant en philosophie est l’un des militants les plus actifs du «Balai citoyen». Ce mouvement de désobéissance civile a été créé il y a un peu plus d’un an avec l’objectif de «balayer» le régime Compaoré, en commençant par l’empêcher de se représenter. Il se revendique ouvertement de l’héritage de Thomas Sankara. Pendant les récentes manifestations, ses membres se sont retrouvés en première ligne. Mais si la mobilisation a réussi à chasser aussi rapidement l’homme fort du pays, réputé indétrônable, c’est également parce que le terrain avait été préparé à l’avance.
«Le déclic, ce fut le scrutin de 2012, se souvient Guy-Hervé Kam, un avocat d’affaires. Les élections municipales et législatives ont surtout renforcé l’aile la plus dure du parti de Compaoré, le Congrès pour la démocratie et le progrès. On a alors compris que rien n’arrêterait le régime dans sa course à la survie. Il fallait donc sortir de nos bureaux, susciter un vrai mouvement populaire et, surtout, convaincre les jeunes des quartiers déshérités, souvent désabusés, que la question du pouvoir était plus importante que le foot.» Ce quadragénaire à l’allure moderne, très casual chic, est le porte-parole du Balai citoyen. Et également un peu son mentor. Il ne faut pas se fier aux apparences : lui aussi a un passé de rebelle. «J’ai longtemps été un activiste un peu isolé», raconte-t-il en souriant derrière son bureau, installé dans une villa discrète au cœur de Ouagadougou. Nommé à 28 ans secrétaire général du syndicat de la magistrature, il se lance alors dans une virulente campagne contre la corruption qui le contraindra à la mise au placard puis à la démission.
Tirant les leçons de ses déboires passés, Guy-Hervé Kam a insufflé, avec d’autres, l’originalité du mouvement citoyen : «On a organisé des caravanes avec concerts et meetings dans les quartiers populaires. On parlait aux jeunes en moré, la langue la plus usitée ici, et non plus en français. Ils ont tout de suite adhéré : enfin on parlait leur langage, on les rassemblait autour d’artistes qu’ils connaissaient.» Le Balai citoyen a aussi mis en place des «barrages pédagogiques» : «À la mi-octobre, on a plusieurs fois bloqué toutes les artères principales de la ville en même temps pendant deux heures pour diffuser des slogans de mobilisation avec des mégaphones», se souvient Guy-Hervé Kam. L’avocat rappelle aussi la création des Cibal, ces clubs de «citoyens balayeurs» qui «se sont tellement multipliés dans les quartiers, les collèges, les universités, qu’on ne peut plus les compter !»
Il ne cache pas sa fierté à l’évocation de cette organisation prérévolutionnaire : «Quand le moment est venu d’empêcher les députés de voter la réforme constitutionnelle pour permettre à Blaise de se représenter, tout le monde était prêt pour l’épreuve de force.» Il y eut certes des moments de flottement. «Quand j’ai vu le dispositif militaire déployé dans la ville ce 30 octobre, le jour prévu pour le vote, je me suis dit : « Waouh, c’est gâté ! » reconnaît-il. Mais les jeunes étaient déterminés, ils m’ont dit : « On y va, on passe en force. » Et c’est comme ça qu’on a pris d’assaut l’Assemblée et empêché le vote. Le lendemain, Blaise quittait le pays.» Tout est allé si vite que personne n’a anticipé la suite. Les lendemains de révolution sont souvent difficiles à gérer, même dans un pays qui se réclame d’un héros sacrifié.
«Nous resterons une sentinelle»
Bien qu’inspiré par Thomas Sankara, le Balai citoyen se refuse à imposer des options idéologiques : «Dans ce pays, nous n’avons pas besoin de théorie, affirme Guy-Hervé Kam. Nous avons des problèmes concrets : permettre aux enfants d’aller à l’école, offrir eau potable et nourriture à tout le monde. Tout ce qui ira dans ce sens sera positif.» Son mouvement refuse de participer au nouveau pouvoir : «Nous resterons une sentinelle, la mauvaise conscience des gouvernants», assure-t-il. «Le peuple a décidé que l’exercice du pouvoir ne se ferait pas sans lui : ça, c’est du Sankara ! Mais il est mort il y a près de trente ans et son discours doit être adapté aux défis du monde actuel. Or, dans ce pays, nous n’avons pas d’avant-garde politique dans laquelle la population se reconnaîtrait spontanément», avoue Bénéwendé Sankara, le leader du principal parti d’opposition dit «sankariste» (sans lien de parenté direct avec Thomas Sankara). Ce mouvement n’a été créé qu’en 2000, dans la foulée de la vague de contestation qui avait suivi le meurtre de Norbert Zongo.
Au bout d’une route de latérite rouge, le siège de ce parti est un véritable petit musée en l’honneur du héros disparu : dès l’entrée, on tombe sur un grand buste coloré de Sankara, et de multiples portraits ornés de slogans révolutionnaires un peu désuets décorent les salles vétustes. Plutôt populaire, elle est néanmoins restée marginale en raison de ses incessantes divisions.
Dès lors, au lendemain du départ de Blaise Compaoré, la scène politique locale semble dominée par des partis d’opposition «libéraux» ou de droite qui ont suivi, plus qu’ils n’ont anticipé, la colère de la rue. Aux premiers jours de novembre, on pouvait voir leurs leaders errer dans les halls d’un hôtel de luxe, lors des premières tractations pour la transition : silhouettes en costume-cravate, imposantes et assurées, qui semblaient encore marquées par la posture d’anciens ministres de Compaoré que ces hommes ont souvent été avant de rompre soudain avec le pouvoir.
Que restera-t-il de cette révolution d’octobre inspirée par Sankara ? À Ouagadougou, les vautours ont disparu. Les «vrais», ceux qui pendant des années ont déployé leurs lourdes ailes au-dessus du marché central, ne sont plus visibles depuis longtemps. Selon une rumeur persistante, ils auraient été mangés par une population affamée. Les autres — ceux qui accaparaient les richesses du pays — sont depuis peu partis en exil. Mais certains anciens dignitaires du régime restent dans l’ombre. Comme le général Gilbert Diendéré, ancien chef d’état-major particulier de Compaoré, accusé d’avoir envoyé ses hommes assassiner Sankara ce fameux jour d’octobre 1987 qui hante le pays. Toute l’armée était aux ordres de Compaoré. Fallait-il pour autant exclure ce haut gradé de la nouvelle ère ? Certains ont pu reprocher au Balai citoyen d’avoir cautionné la prise du pouvoir par les militaires au lendemain de l’insurrection. «Face au vide du pouvoir, on risquait le chaos ! C’est pour cette raison que nous sommes allés trouver les militaires, pour leur dire de prendre leurs responsabilités en se démarquant de Compaoré et en assurant le retour de la sécurité», se défend Me Kam, qui trouve cependant «gênant» le maintien du général Diendéré à l’état-major.
«Un goût d’inachevé»
Mais au pays des hommes rebelles, il y a d’autres adversaires tapis dans l’ombre. À commencer par cette survivance archaïque : le Parti communiste révolutionnaire voltaïque, ouvertement stalinien, a été créé dans la clandestinité sous la colonisation. Officiellement, personne ne connaît ses membres ni même ses dirigeants. Pourtant, les très puissants syndicats burkinabés lui obéissent aveuglément. C’est pour cette raison qu’ils ont loupé le coche de la révolution, restant singulièrement absents lors de ces journées historiques au cours desquelles le destin du pays a basculé. «Ils ont conclu un pacte avec Blaise. Ils menaient leurs luttes mais sans réellement remettre en cause le régime, au nom d’une « vraie alternative » toujours en attente. Désormais, ils tentent de saper la réputation du Balai citoyen», assure Zinaba.
Alors que le jeune activiste quitte la cantine du centre de presse Norbert-Zongo, un homme l’interpelle joyeusement : «Mon frère ! Ça y est, on a presque fini !» «Non, on n’a pas encore commencé», lui répond d’une voix lasse Zinaba. Il soupire : «La révolution a encore un goût d’inachevé. Il nous faut construire, tout en nous occupant de nos ennemis.» À la fin du mois, il se rendra sur la tombe de Thomas Sankara : «Je lui dirai que non seulement nous avons vengé sa mort, mais que nous avons aussi fait revivre son esprit, son rêve de liberté.» Avant de s’éloigner, pour aller se replonger dans ses recherches sur «l’humanisme dans l’œuvre de Karl Marx», son sujet de maîtrise.
Publié par des ennemis de la révolution burkinabé (Maria Malagardis Envoyée spéciale à Ouagadougou, Liberation.fr, 14 novembre 2014)















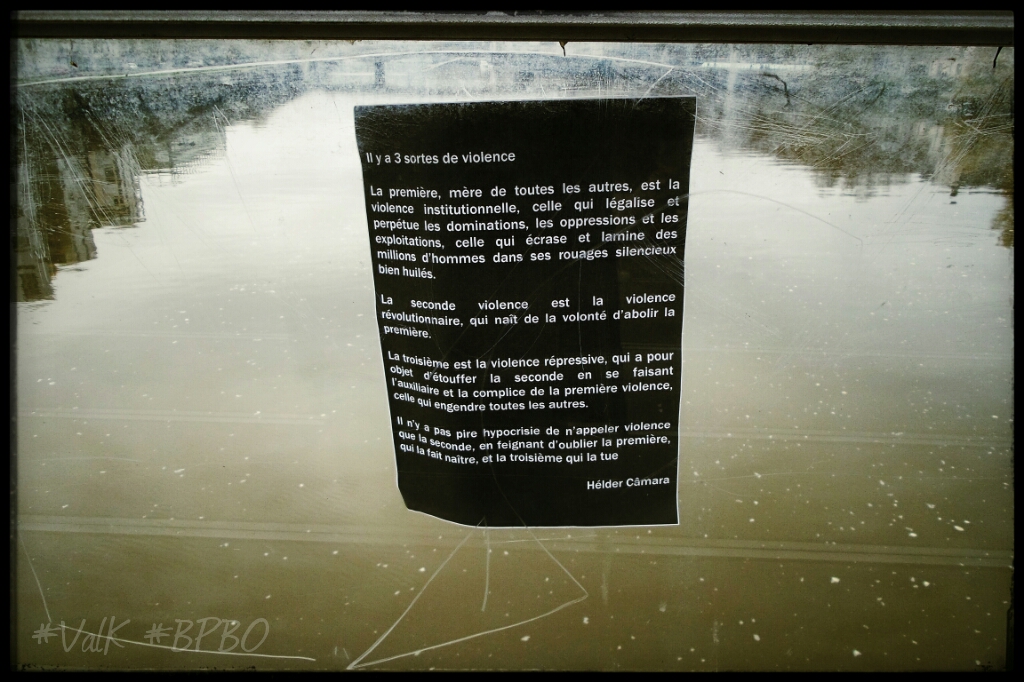














 Aleksandr Kolchenko: I am not a terrorist. I am a citizen of Ukraine.
Aleksandr Kolchenko: I am not a terrorist. I am a citizen of Ukraine.










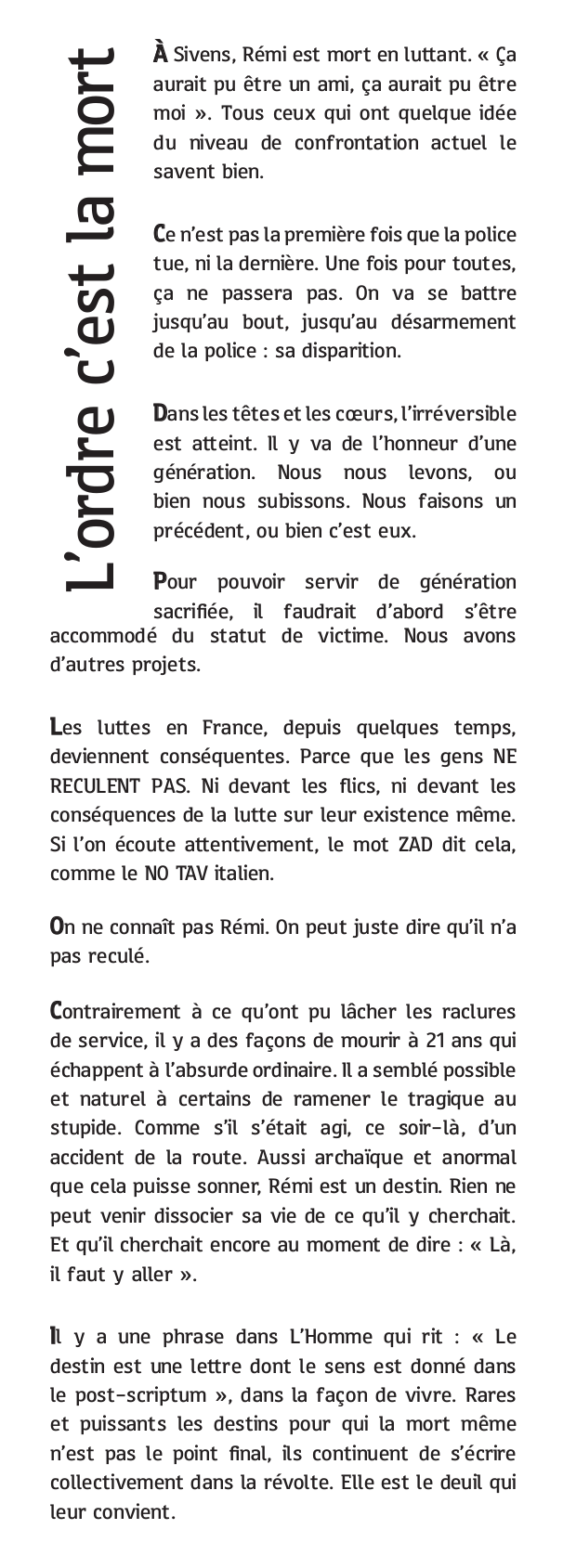




 La manifestation des flics d’Alliance perturbée
La manifestation des flics d’Alliance perturbée