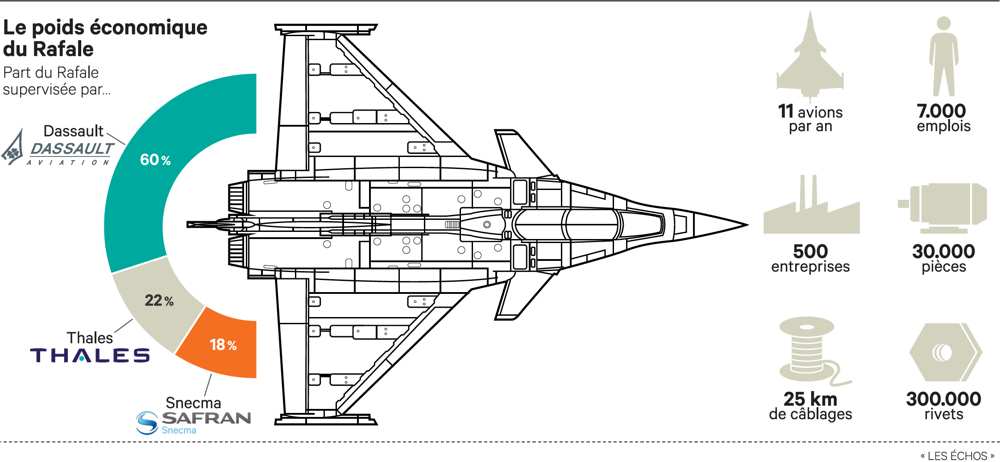Principes de contre-insurrection
Le 25 janvier 2011 débutait une insurrection sans précédent en Égypte qui provoqua, comme on le sait, la chute de Moubarak, au pouvoir depuis trente ans. Insurrection qui se vit assez rapidement matée par une coalition éclectique constituée par tout ce qui pouvait exister de conservateur dans le pays. Dans les mois qui suivirent, les Frères musulmans qui avaient participé aux manifestations comme à l’occupation de la place Tahrir et qui s’étaient révélés des forces indispensables à l’affrontement des militaires (souvenons-nous de la bataille des dromadaires) désertèrent les rues pour s’allier au SCAF (Supreme Council of Army Forces), gouvernant par défaut, et à une coalition démocratique mise en place afin d’assurer une « transition ordonnée » ainsi que l’avaient appelée de leurs vœux l’armée égyptienne, et Hilary Clinton. Comme on le sait, cette « transition démocratique » ne s’est pas si bien passé que cela pour toute la clique de militaires et de bourgeois tenant les rênes du pays comme de son économie. Grâce à leur candidat, les Frères musulmans (ikhwan en égyptien) triomphèrent lors des élections présidentielles de juin 2012, premières élections mises en place depuis la chute de Moubarak. Déjà fragilisé par des projets économiques mettant à mal les intérêts des militaires, le nouveau gouvernement se heurte un an plus tard à des mouvements de protestation de masse, qui donnèrent lieu aux bains de sang que l’on sait en juin et juillet 2013 lors de l’intervention répressive de l’armée et au coup d’État du 3 juillet. De nouvelles élections ont lieu au cours de l’année 2014. Dans un climat de terreur, de dépression et de fatigue, un autre militaire se fait élire, toujours en place aujourd’hui.
Il y a deux semaines, nous étions le 25 janvier, Il s’agissait, cette année, du quatrième anniversaire de cette révolution incroyable mais défaite. Signe de cette défaite, les rues autour de la place Tahrir sont demeurées désertes. Dans les quartiers plus éloignés, l’ambiance était celle d’un jour férié un peu morne, du genre de ceux dont on a oublié l’origine, de ceux dont l’institution même vise à recouvrir l’essence et la vitalité de l’événement originel – comme un 1er mai français. Quelques vendeurs promènent leur charrette de fruits et légumes, des enfants jouent au foot, les adultes les surveillent du coin de l’œil, depuis la terrasse d’un café ou l’intérieur de leur maison.
Quant aux révolutionnaires : à la suite de débats véhéments au cours de la semaine précédente, ils ont renoncé à sortir et à manifester. Ils se terrent donc tristement chez eux, ou dans leurs différents locaux. Cette décision a été prise dans la perspective d’une énorme manifestation des pro-Sissi, organisée par le gouvernement afin de célébrer et commémorer les événements à l’origine de l’époque nouvelle, autrement dit afin de glorifier le régime. Malheureusement, deux jours avant le fameux 25 janvier, Al-Sissi annonce l’annulation des festivités, au prétexte du deuil national de sept jours qu’il a lui même décrété à la suite de la mort du roi d’Arabie saoudite. Ces lâches manœuvres de politique retors ont eu pour effet ce que visait effectivement le pouvoir en place : un 25 janvier où il ne se passe rien.
Pour être tout à fait exact, quelques petites choses ont eu lieu : le syndicat de journalistes situé au nord de la place Tahrir ayant tout de même appelé à un rassemblement, une quarantaine de personnes se sont réunies avant de voir leur cortège bloqué par les forces de l’ordre et dispersé en un instant. Une vingtaine de Frères musulmans ont trouvé la mort, dans un quartier pauvre et sans grand renom du Caire, la Matareya, lors d’une manifestation rassemblant environ 450 personnes, sans que cela provoque un grand remous national.
La veille, un événement d’une autre envergure – si l’on compare les traitements médiatiques et l’activité des réseaux sociaux – a eu lieu : une jeune militante de l’Alliance populaire socialiste, un collectif formé pendant la révolution, est abattue d’une balle dans le dos alors qu’elle participait à un rassemblement parti de la place Talaat Harb et visant la commémoration des martyrs de la révolution. La photo de Shaima el-Sabbagh s’effondrant, la tête ensanglantée et retenue dans sa chute par l’un de ses camarades, fait le tour du monde. Dès le 24 au soir, l’Égypte s’agite sur Facebook, Twitter et ses réseaux de journaux indépendants. Le 25, elle laisse les places vides.
L’Occident, comme a son habitude, fait de Shaima el-Sabbagh une martyre de la violence démesurée d’une junte autoritaire ayant trahi la révolution. Cependant, une telle analyse ne rend compte ni de l’intelligence du pouvoir en place, ni des stratégies efficaces dont il use pour justifier ses actes, ni du silence assourdissant de la presse « critique » lorsqu’Al-Sissi rencontre Hollande puis Merkel. Et, pour cause, ces stratégies sont les mêmes que celles employées par la contre-insurrection occidentale, tirant sur les mêmes cordes, celle de la lutte contre le terrorisme (et son corollaire, la valorisation de la police), celle de la légitimité, et celle de la guerre civile. Ce sont de telles stratégies qui étaient à l’œuvre au cours des derniers événements ici relatés, menant à l’étouffement et la sclérose de la voie spécifiquement révolutionnaire de l’insurrection égyptienne et à la désertion de la place Tahrir. Le pouvoir fait certes un usage massif de la violence, dans l’intention de répandre la peur dans le cœur de tout citoyen, mais il ne le fait pas sans distinction ni orientation.
1. Terreur
La logique de terreur, on l’aura compris, est un des outils principaux de la répression massive mise en place par le gouvernement pour éviter tout rassemblement, toute réappropriation des rues. Une des premières mesures prises par l’armée après le coup d’État a ainsi été de permettre l’usage de la « force meurtrière » à l’encontre des manifestants ainsi que de rendre plus arbitraire encore la décision d’autorisation des manifestations – celles-ci pouvant être interdites si elle représentent une « menace pour la sécurité ». Le corollaire de cette mesure étant des peines de prison démesurées pour tout participant à une manifestation interdite (de 3 ans à 15 ans d’enfermement – la peine de mort a même été proposée pour punir les plus gros fauteurs de troubles).
La mort de Shaima el-Sabbagh, la veille de l’anniversaire en question, relève clairement de cette même logique. Celle-ci meurt d’une balle dans le dos tiré par un policier situé de l’autre côté de la place sur laquelle se sont rendus des membres de l’Alliance populaire socialiste avec une banderole sur laquelle on peut lire le nom de leur parti et une couronne de fleurs destinée à rendre hommage aux martyrs de la révolution, chose somme toute assez conventionnelle.
Le pouvoir a beau se défendre en accusant un voyou armé (baltagy) ou un ikhwan fanatique (le ministre de la Santé a affirmé que l’analyse de la balle ne pouvait prouver si elle avait tirée par un civil ou un policier), pour tous, il est clair que « c’est le ministre de l’Intérieur qui a assassiné Shaima », afin que sa mort serve d’avertissement à tous ceux qui tenteraient d’enfreindre le lendemain l’interdiction de manifestation décrétée par le gouvernement.
Tout ceci montre bien que le gouvernement n’a qu’une peur : que des gens se retrouvent dans la rue, se rencontrent véritablement (plutôt que sur les réseaux sociaux) une nouvelle fois et reprennent possession de ce qu’ils avaient si durement conquis en 2011.
Des efforts logistiques spectaculaires sont déployés à cet effet. La station de métro de la place Tahrir est ainsi fermée depuis 2011 sans que l’on sache quand elle sera rouverte. Des portes en acier ainsi que des feux tricolores malheureusement constamment rouges et munis de caméras de surveillance ont été installés sur la plupart des rues permettant l’accès à la place et aux ministères situés aux alentours sud de celle-ci. Le 25 janvier, des tanks ont été déployés sur toute la place, gardant ses entrées, derrière des barbelés. Il en avait été de même lors de la manifestation des salafistes et des Frères musulmans le 19 novembre dernier. On le sait moins, mais des snipers sont également souvent postés aux sommets des bâtiments officiels situés sur la place ou à ses alentours, prêts à tirer à balle réelles sur les manifestants.
Cet usage massif de la violence n’a pas été institué sans étape ni sans discours idéologique le justifiant. Il a fallu pour ça une intense propagande à la gloire de la lutte antiterroriste. Ce terme de terroriste a d’abord servi à l’armée pour désigner le conflit que dès 2013 elle engage contre les Frères musulmans et autres salafistes du pays, quand bien même c’est le coup d’État du SCAF et l’interdiction du parti des Frères musulmans qui a mené au basculement des ikhwan dans l’illégalité. L’armée s’est fabriqué les ennemis intérieurs dont elle avait besoin pour justifier ses exactions. On ne peut pas dire que les Frères ne l’y ont pas aidée, assumant immédiatement cette étiquette, passant très vite à une lutte plus violente — attentats contre la police et l’armée, au Caire comme dans le désert du Sinaï. Progressivement, au prétexte de la protection de l’État et du régime, l’armée a étendu la catégorie de « terroriste » à d’autres groupes protestataires en Égypte, par exemple, le mouvement des jeunes du 2 avril, récemment déclaré « organisation terroriste ». Cette étiquette présentent deux avantages pour l’armée et le pouvoir en place : la mise en place d’un état d’exception juridique absolument incroyable et l’étouffement des particularités des groupes identifiés comme terroristes.
2. Légitimité
Cette guerre contre le terrorisme qui paralyse tant de révolutionnaires en Égypte n’est cependant pas le seul artifice dont le pouvoir en place se drape pour conserver sa position et prévenir toute offensive, qu’elle soit islamiste ou révolutionnaire. L’armée mène aussi une guerre à la mémoire révolutionnaire, s’efforçant de se réapproprier consciencieusement ce qui avait été vécu dans les rues et sur les places.
Ainsi, l’armée, depuis 2011, s’est constamment efforcée de ne jamais apparaître comme l’ennemie des manifestations de la place Tahrir, étendues progressivement au pays entier. Dès les premières semaines, elle qualifie les revendications du peuple de « légitimes », et s’affirme comme un acteur de la « transition » exigée par le peuple. Lors du coup d’État, c’est encore parce qu’elle est au service du peuple qu’elle agit : ayant entendu son refus du gouvernement des Frères musulmans, elle s’autorise à déloger le président en place. Les militaires se présentent comme le bras armé des manifestants et du peuple égyptien dans son ensemble. Elle est l’arche sainte de la nation, la gardienne de la révolution. Toute la légitimité du pouvoir en place, bien qu’il soit structurellement identique à celui de Moubarak, lui vient de la révolution. Il en fait le moment extraordinaire de communion du peuple, de proclamation d’un accord commun et unanime sur le changement de régime et, par conséquent, de constitution du nouveau pouvoir, bref, un contrat social en bonne et due forme, renvoyant à un consensus primordial et inquestionnable. Dès lors, la révolution devient un mythe, c’est-à-dire un récit d’un temps révolu et inaccessible parce que situé dans une autre temporalité, expliquant le sens du monde, dans la mesure où un tel mythe est nécessaire au pouvoir pour expliquer sa constitution. Or, au mythe, on ne rend jamais qu’un devoir de mémoire. Ainsi, on rend férié le jour anniversaire de la révolution, mais également, avant chaque micro-événement, pièce de théâtre, concert, conférence, on fait une minute de silence pour les martyrs de cette révolution, comme si ces morts étaient ce qui aujourd’hui permet le fonctionnement des institutions.
Il est donc normal que le pouvoir fasse du 25 janvier un jour férié dédié à la célébration du régime en place, héritier direct et légitime de la révolution populaire de 2011. Il est aussi tout à fait logique qu’il contrôle les allées et venues sur Tahrir en un tel jour : il n’est pas question que n’importe qui vienne voler au peuple égyptien sa révolution, et surtout pas des ikhwan machiavéliques et manipulateurs. C’est le premier objectif : clore la révolution afin que l’on n’ait plus à la vivre mais simplement à s’en souvenir.
Le deuxième objectif est de conférer à la révolution une valeur si générale et universelle que plus personne depuis sa situation particulière ne puisse jamais s’en ressaisir. Objectif lui aussi atteint le 25 janvier dernier. En effet, si l’on a fermé Tahrir, on n’a pas empêché pour autant que des manifestations aient lieu dans d’autres quartiers du Caire, la Matareya par exemple. Le 25 janvier, il y eut une vingtaine de morts dans ce quartier où environ 450 personnes s’étaient rassemblées, à quoi s’ajoute une centaine d’arrestations. Or, on a pu remarquer que dans les média occidentaux et même dans les média égyptiens dits indépendants, c’est-à-dire ne participant au mouvement général de propagande nationaliste et antiterroriste, ces événements étaient bien moins relayés que le meurtre d’une militante de gauche dans les rues du centre ville du Caire. Alors que de nombreuses photos de Shaima el-Sabbagh ont directement circulé sur les réseaux sociaux, les morts de la Matareya n’ont attiré que peu de commentaires, ou même de journalistes. Il n’est pas question ici d’incriminer les journalistes ou bien les fortes émotions qu’a provoqué la mort de Shaima el-Sabbagh, mais bien de pointer une curieuse centralité qui, malheureusement, fait le jeu du pouvoir.
3. Centralité
L’Égypte est un des pays les plus centralisés de la planète, d’abord autour du Nil, puis aujourd’hui de sa capitale, qui abrite plus de 20 millions d’habitants. Cette centralisation est telle que les habitants de Haute-Égypte n’appelle pas Le Caire « al-Qahira » comme tous les cairotes, mais « Misr », ce qui signifie tout simplement Égypte. La ville elle-même subit un sort identique : ainsi le quartier de la place Tahrir s’appelle « centre ville » ou « centre du pays » selon la traduction choisie. Ainsi, ceux qui se révoltent contre le système en place ont toutes les raisons de se diriger place Tahrir puisque c’est là que se situent la plupart des institutions qu’ils cherchent à destituer. Or cela donne au pouvoir l’opportunité de faire la sourde oreille, et de faire semblant de comprendre que les manifestants choisissent cette place pour se placer sur le niveau national, s’adresser à tout le pays d’une voix claire, unie et légitime. Sont ainsi disqualifiées toutes les voix un peu trop situées, toutes les tentatives politiques un peu trop spécifiques à une certaine forme de vie. Tahrir impose une forme d’uniformisation de la contestation, uniformisation qui condamne par avance ladite contestation à servir, tranquillement, l’avancée de la contre-insurrection.
Tout ceci place les révolutionnaires dans la réaction et la dénonciation des mensonges du gouvernement plutôt que dans l’affirmation positive d’une forme politique spécifique et située. La révolution pour laquelle ils se battent ne dépasse donc pas le stade du signifiant mythique, mais vide. Pourtant, les révolutionnaires défaits mènent pied à pied une lutte symbolique de réappropriation de la révolution. Des collectifs, tels 3askar Kazaboun (armée = menteurs), ont été créés, dont le but est de réunir et de diffuser des vidéos démontrant le mensonge sur lequel tente de s’édifier le pouvoir en place. L’agression par la police des manifestants de l’Alliance populaire socialiste le samedi 24 janvier se comprend au sein de cette même guerre : déterminés à déposer une gerbe de fleurs sur la place Tahrir en hommage aux martyrs de « leur » révolution, ces activistes se déclaraient ouvertement hostiles à la commémoration officielle et, donc, ennemis du régime. De la même façon, des révolutionnaires expliquent que s’ils refusaient de descendre dans les rues le 25 janvier, c’était essentiellement parce qu’ils y voyaient un dispositif théorique, médiatique et spatial tel qu’ils ne pourraient que se faire « voler » leur manifestation, ou bien en étant étiquetés libéraux-démocrates, ou bien en étiquetés terroristes. La troisième voie qu’ils cherchent, la ligne proprement révolutionnaire, peine à exister tant sont liées en Égypte les notions de démocratie et de terrorisme, le second n’étant que le dehors de la première, qu’elle ne sait nommer autrement.
Que signifient donc les évènements des dernières semaines ? La victoire de la contre-insurrection en Égypte est totale. Quatre ans après, il n’y a autour de Tahrir que des rues vides et des échoppes fermées. Les seuls à arpenter les rues sont les flics en civil, qui indiquent aux rares passants la direction de fausses manifestations. Il ne reste de l’insurrection que la lutte pour un symbole, un mythe que l’on ne peut plus toucher, tellement on l’a sacralisé. Un tel succès de la réaction peut dérouter plus d’un révolutionnaire, et mène fatalement à l’abandon de ce symbole à une force unifiée, universelle, à la hauteur de ce genre de divinisation. Peut-être que, tout simplement, cette révolution mythique est devenue un enfer, un enchaînement glacial de meurtres sordides et de répression rusée – un enfer qu’il ne sert plus à rien de défendre.
Lundi Matin #10, 9 février 2015